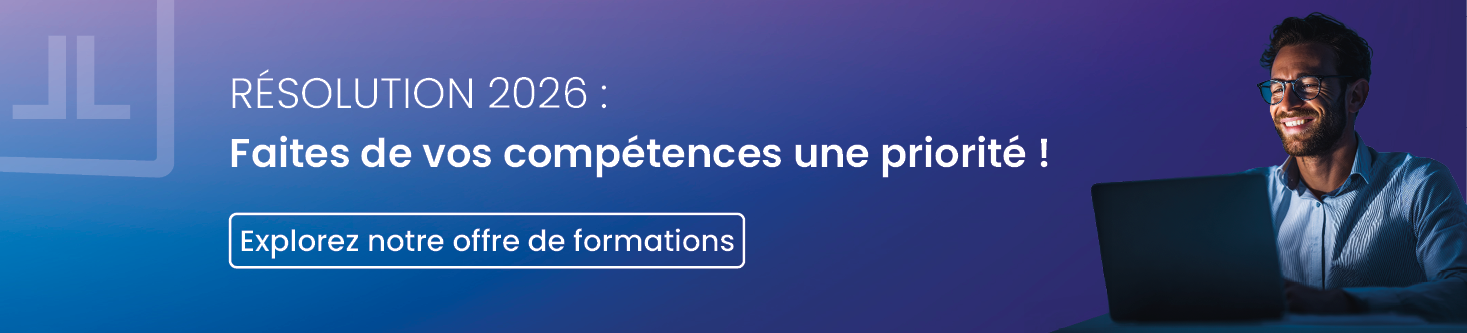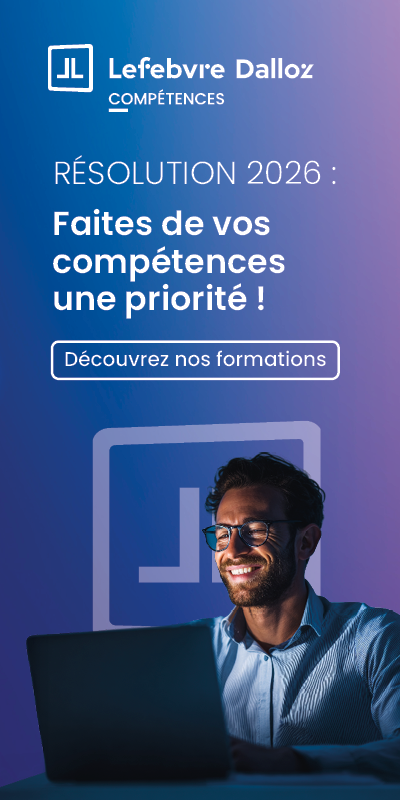Le calcul des heures travaillées est une notion essentielle en gestion de la paie. Il est donc indispensable de bien maîtriser les règles en matière de durée du travail et les différentes modalités de calcul des heures qui doivent être payées aux salariés.
Mais quelles sont les règles en matière de temps de travail ? Et comment calculer les heures de travail des salariés ?
Dans cet article, nous vous proposons un tour d’horizon complet des modalités de calcul des heures de travail.
La durée légale de travail : Comment ça marche ?
Pour bien traiter la paie d’un salarié, il est fondamental de comprendre le fonctionnement de la durée légale du travail, les règles encadrant les durées maximales autorisées, ainsi que les durées minimales de repos imposées par le Code du travail.
Ces notions sont essentielles pour s’assurer de la conformité des pratiques RH et éviter tout risque de contentieux ou de redressement.
Par ailleurs, le respect des règles en matière de temps de travail conditionne l’éligibilité à certaines réductions de cotisations sociales, notamment celles applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires.
Les heures de travail, c’est quoi ?
Selon le Code du travail, est considéré comme du temps de travail effectif toute période durant laquelle le salarié :
- Est à la disposition de l’employeur ;
- Se conforme à ses directives ;
- Ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce sont ces heures qui servent de base pour le calcul de la rémunération, des heures supplémentaires ou de certaines exonérations de cotisations comme la réduction générale de cotisations patronales (RGCP).
Plusieurs situations spécifiques sont assimilées à du temps de travail effectif au regard du calcul des heures supplémentaires, et notamment :
- Le temps d’habillage et de déshabillage (si imposé par le règlement intérieur ou la convention) ;
- Les temps de déplacement professionnel durant les horaires habituels ;
- Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte ;
- Les congés pour formation, naissance ou événements familiaux ;
- Les absences pour mandat de représentant du personnel ;
- Les jours fériés chômés (sous réserve de l’interprétation jurisprudentielle) ;
- Le repos compensateur de remplacement ;
- La contrepartie obligatoire en repos.
La durée légale du travail
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail). Il ne s’agit cependant pas d’une durée obligatoire, mais d’un seuil déclencheur du paiement des heures supplémentaires, sauf dans les cas où une durée d’équivalence est prévue.
Autrement dit, une entreprise peut organiser une durée collective de travail supérieure ou inférieure à 35 heures hebdomadaires, sous réserve de respecter les règles relatives :
- Au contingent annuel d’heures supplémentaires ;
- Aux majorations applicables ;
- Et à la durée maximale hebdomadaire du travail.
À noter : Dans une entreprise dont la durée collective est inférieure à 35 heures, les heures accomplies au-delà de cette durée interne, mais en-deçà de 35 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens du Code du travail et n’ouvrent pas droit aux réductions de cotisations afférentes.
Toutefois, elles doivent être rémunérées au minimum au taux normal.
Dans certains secteurs (transport, gardiennage , santé, …), une durée d’équivalence supérieure à 35 heures peut être définie. Cette durée remplace alors la durée légale pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Quelles sont les limites maximales du temps de travail ?
La durée maximale quotidienne
Principe : Un salarié ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour (article L. 3121-18 du Code du travail). Toutefois, des dérogations sont possibles :
- Par accord collectif : un accord d’entreprise ou de branche peut porter cette limite à 12 heures. L’accord d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche ;
- Sur autorisation de l’inspection du travail : en cas de surcroît d’activité imposé ou en cas d’urgence, une dérogation peut être accordée par l’inspection du travail.
À noter : Un salarié ayant dépassé la durée maximale sans dérogation doit être indemnisé, même sans prouver de préjudice (Cass. soc. 11 mai 2023, n° 21-22281).
A lire également :
- Réduction générale 2026 : quelles sont les nouvelles règles ?
- Paiement des congés payés non pris : Quelles sont les règles ?
- Journée de solidarité : qu’est-ce que c’est ? Comment la traiter en paie ?
La durée maximale hebdomadaire
Principe : La durée du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine (article L. 3121-20 du Code du travail).
Dérogation : En cas de circonstances exceptionnelles, cette limite peut être portée à 60 heures, sur autorisation de l’inspection du travail.
À noter : Le dépassement ouvre droit à des dommages-intérêts, même sans preuve de préjudice.
Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines
Principe : La moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures (article L. 3121-22 du Code du travail).
Dérogation conventionnelle : Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à défaut une convention ou un accord de branche, peut relever cette moyenne à 46 heures.
Dérogation sur autorisation : À défaut d’accord, une autorisation peut être délivrée par le DREETS pour atteindre 46 heures, en cas de circonstances exceptionnelles.
Dérogation au plafond de 46 heures : Dans certains secteurs, régions ou entreprises, une autorisation exceptionnelle peut permettre de dépasser cette limite, à condition de respecter une procédure définie dans le Code du travail.
Votre processus de recrutement est-il prêt pour 2026 ?
Prenez quelques minutes pour faire le point sur vos pratiques de recrutement. Ce quiz rapide vous permet d’obtenir une vision claire de votre situation actuelle et de mieux comprendre les axes d’amélioration possibles pour la suite. Ce quiz vous est proposé par notre partenaire Tellent.
Je fais le testCompensation obligatoire
Lorsque le repos quotidien est réduit, le salarié doit impérativement bénéficier d’une période de repos équivalente, ou, à défaut, d’une contrepartie équivalente prévue par accord collectif
Des exceptions pour certains salariés
Jeunes de moins de 18 ans
Les jeunes salariés de moins de 18 ans sont soumis à des durées du travail plus strictes. Sauf dérogation, ils ne peuvent pas travailler plus de :
- 8 heures par jour ;
- 35 heures par semaine.
Dans certains secteurs d’activité ou dans certaines circonstances, des dérogations sont admises.
Travailleurs de nuit
Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit voient également leur temps de travail encadré. En principe :
- La durée quotidienne maximale est fixée à 8 heures ;
- La durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures.
Un accord collectif peut porter cette limite hebdomadaire à 44 heures si l’activité du secteur le justifie. Par ailleurs, de la même manière que pour le travail des jeunes, des dérogations sont prévues en fonctions du secteur d’activité ou dans des cas spécifiques.
Salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires de travail . Cependant, deux limites continuent de s’appliquer :
- Le repos quotidien : 11 heures minimum sauf cas dérogatoires ;
- Le repos hebdomadaire : 35 h minimum dont le dimanche sauf cas dérogatoires.
L’accord de forfait doit prévoir des garanties sur la charge de travail, le droit à la déconnexion et le suivi des temps de repos. Il est donc important, même pour ces catégories de salariés non soumises à un horaire collectif, de comptabiliser leur temps de travail afin de garantir le respect des règles en matière de temps de travail.
Comment calculer les heures de travail ?
Savoir calculer la durée légale du travail et le travail effectif est un impératif pour une paie juste et conforme à la législation. En effet, ces notions ont un impact direct sur le calcul de la rémunération mensuelle du salarié et du paiement des heures supplémentaires (ou complémentaires).
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Cette référence hebdomadaire permet de décliner la durée du travail en différentes périodicités utilisées en paie :
La durée moyenne mensuel
La durée légale équivaut à 151,67 heures. Cette donnée est calculée de la manière suivante : 35 h × 52 semaines ÷ 12 mois. Elle sert de base pour le calcul de la rémunération des salariés mensualisés.
Cette méthode de conversion est également utilisée pour déterminer l’horaire moyen mensuel des salariés à temps partiel.
Exemple : un salarié travaillant 28 heures par semaine a un horaire mensuel moyen de : 28 h × 52 ÷ 12 = 121,33 heures.
À quoi correspond les 1607H de travail annuel ?
Annuellement, la durée légale est fixée à 1 607 heures. Cette donnée est obtenue de la manière suivante :
365 jours travaillés
– 104 jours de repos hebdomadaire (2 X 52)
– 25 jours ouvrés de congés payés
– 8 jours fériés en moyenne
= 228 jours travaillés
228 X 7 heures = 1596 heures arrondi à 1600 heures auquel on ajoute les 7H de la journée de solidarité, soit 1607 heures par an.
Cette base annuelle est utilisée comme référence dans plusieurs cas et notamment :
- Pour les entreprises ayant mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année ;
- Pour le calcul des droits à RTT (réduction du temps de travail) ;
- Pour évaluer la durée annuelle d’un contrat de travail en forfait heures.
Les heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires (ou de la durée d’équivalence si elle est applicable). Elles doivent être rémunérées avec une majoration de salaire ou compensées par un repos équivalent dans certaines conditions.
À noter : L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche concernant les contreparties salariales des heures supplémentaires, même si moins favorable pour le salarié sans que la majoration puisse être inferieure à 10%.
Concernant les salariés à temps partiel, il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, mais d’heures complémentaires. Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle qui peuvent être réalisées dans une certaine limite.
- Pas d’accord d’entreprise ou de branche : Jusqu’à 10% de la durée contractuelle ;
- Accord d’entreprise ou de branche : Jusquà 1/3 de la durée contractuelle.
À noter : Comme pour les heures supplémentaires, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche, même si moins favorable pour le salarié.
Exemple :
Sur un mois donné, un salarié réalise les heures suivantes :
| Semaine | Nombre d’heures pas semaine |
|---|---|
| Semaine 1 | 36 |
| Semaine 2 | 38 |
| Semaine 3 | 36 |
| Semaine 4 | 37 |
Il n’a pas d’absence non considérées comme du temps de travail effectif sur le mois.
- Temps de travail mensualisé : 151,67 heures
- Heures supplémentaires : 7 heures
- Total heures travaillées : 158,67 heures
Les heures supplémentaires structurelles : Un traitement en paie particulier
Les heures supplémentaires structurelles sont des heures intégrées de manière habituelle dans l’organisation du travail d’un salarié. C’est notamment le cas lorsque l’horaire collectif de travail est supérieur à la durée légale du travail (par exemple 39H) et que la compensation n’est pas accordé au salarié sous la forme de RTT, mais d’une rémunération complémentaire.
Les règles de compensation sont généralement définies par accord collectif. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont lissées sur l’année de la manière suivante :
Nombre d’heures hebdomadaire au delà de 35H X 52 ÷ 12
Ces heures sont soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires classiques en matière de majoration, de repos compensateur, de plafonds et d’exonérations. Toutefois, leur caractère régulier permet à l’employeur de les intégrer directement dans la rémunération mensuelle du salarié.
Exemple :
Un établissement a un horaire collectif de 39 H. La durée du travail au delà de la durée légale est rémunérée en heures supplémentaires avec une majoration de 25%.
- Temps de travail mensualisé : 151,67 heures
- Heures supplémentaires structurelles : 4 X 52 ÷ 12 = 17,33 heures
- Total heures travaillées : 169 heures
A lire également :
- Comment calculer une absence en paie ?
- Traitement de la paie : les étapes pour assurer la conformité de la paie
- Rappel de salaire sur décision prud’homale : comment ça marche ?