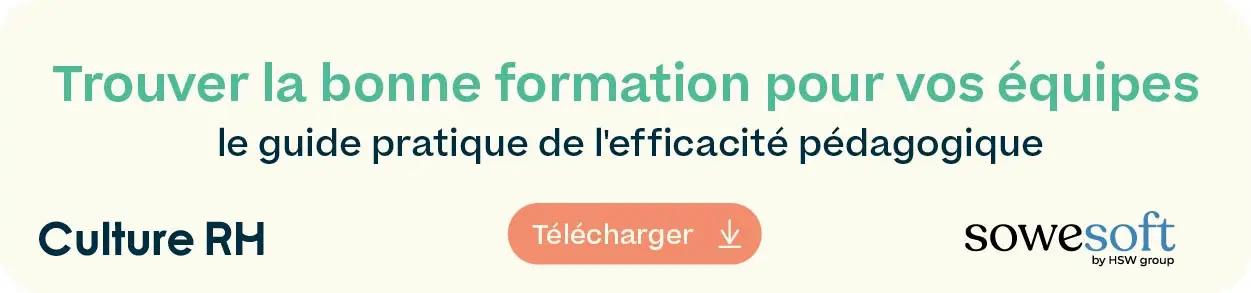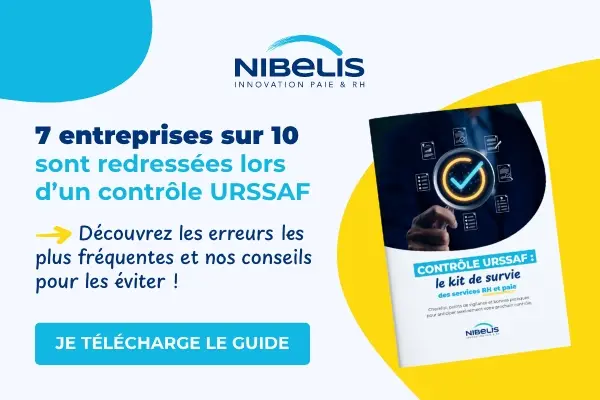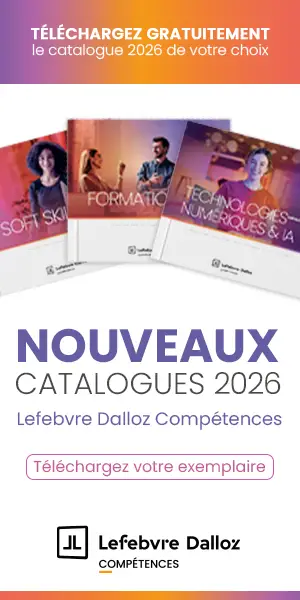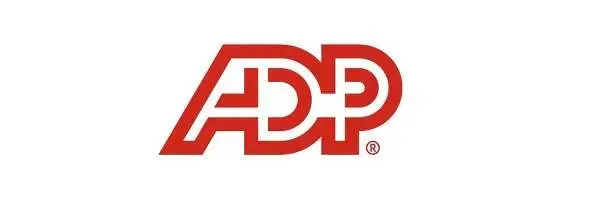La crise sanitaire, combinée à l’arrivée de la génération Z sur le marché du travail, a profondément modifié les attentes des collaborateurs.
La gestion des compétences : un enjeu stratégique pour préparer l'avenir
En 45 minutes, découvrez comment faire de la gestion des compétences un outil de pilotage RH à part entière. Ce webinaire animé par deux experts RH de notre partenaire Eurécia vous donnera des conseils et exemples concrets ainsi que deux outils prêts à l’emploi pour piloter vos compétences au quotidien.
Je m’inscrisBeaucoup remettent en question leur rapport au travail, en quête de sens, d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, d’un climat collectif plus fort, mais aussi d’un rôle plus actif dans les décisions qui les concernent.
Ces évolutions poussent les entreprises à revoir leurs pratiques managériales. Le modèle directif, longtemps dominant, cède peu à peu la place à des approches plus collaboratives.
Parmi elles, le management participatif se distingue comme une alternative de plus en plus explorée. Mais que recouvre exactement cette méthode ? Quelle est sa définition, quels en sont les grands principes, et surtout, comment la mettre en œuvre concrètement ?
À travers cet article, nous verrons ce qu’est le management participatif, avec des exemples à l’appui, ses bénéfices, ses limites, ainsi que les étapes pour le déployer dans une organisation.
Le management participatif, qu’est-ce que c’est ?
Le management participatif repose sur l’implication active des collaborateurs dans la vie de l’entreprise, que ce soit dans les décisions stratégiques, leur mise en œuvre au quotidien ou la gestion des problèmes rencontrés.
Fondé sur un climat de confiance et une communication ouverte, ce mode de management favorise la prise de décision partagée et la délégation concertée avec les équipes.
Il s’inscrit dans une logique de long terme en valorisant l’intelligence collective, avec pour objectif d’améliorer la performance globale de l’entreprise ainsi que la productivité individuelle.
Ce modèle suppose une responsabilisation des salariés, sans pour autant effacer le rôle du manager. Ce dernier conserve une fonction centrale d’accompagnement : il guide, soutient et stimule ses équipes dans l’atteinte de leurs objectifs, tout en veillant au respect des règles et des valeurs de l’organisation.
Même si les collaborateurs gagnent en autonomie dans leur organisation du travail et prennent part aux grandes orientations de l’entreprise, ils restent tenus de rendre compte de leurs résultats.
Pour être réellement pertinent, le management participatif repose sur cinq grands principes structurants.
Quels sont les grands principes du management participatif ?
Comme nous venons de le voir, le management participatif se fonde sur la communication et l’établissement d’une relation de confiance entre le management et les collaborateurs.
Cette relation de confiance doit fonctionner pleinement dans les deux sens pour que le management participatif puisse avoir une chance de porter ses fruits.
Pour ce faire, elle s’appuie sur cinq grands principes qui doivent être appliqués au quotidien au sein des organisations qui pratiquent le management participatif, il s’agit de :
La mobilisation
Le management participatif doit être en mesure de fédérer les collaborateurs (y compris ceux n’occupant pas des fonctions d’encadrement et à responsabilité) autour de projets, d’objectifs et de valeurs communes.
Les collaborateurs doivent avoir le sentiment de faire partie d’un tout et que leur avis et propositions compte tout autant que ceux des autres salariés de l’entreprise.
La responsabilisation et la concertation des équipes
Les collaborateurs doivent non seulement s’investir dans la prise de décision, mais ils doivent également s’investir dans leur réalisation. Dans cette optique, la délégation d’une partie du pouvoir du manager est indispensable.
Ainsi, les collaborateurs auront plus de liberté et de latitude dans l’exécution de leurs tâches. Ce qui compte n’est plus le comment ils y sont parvenus, mais bien le fait qu’ils aient atteint leurs objectifs.
L’amélioration permanente des compétences individuelles et collectives
Le management participatif demandant autonomie, responsabilisation et communication constante, l’acquisition et le renforcement de compétences métiers, mais également des softs skills est un prérequis essentiel à sa bonne marche.
Gestion des priorités, optimisation des process, formation aux nouveaux outils de travail collaboratifs … autant d’outils qui aideront les collaborateurs au quotidien dans l’accomplissement de leurs missions.
La décentralisation de la gestion des conflits
Dans cette logique de responsabilisation et d’autonomie, le management participatif s’applique aussi à la gestion des conflits entre collaborateurs.
Ce mode de fonctionnement repose sur l’idée que les personnes concernées sont les plus à même de trouver une issue au différend. Elles sont donc invitées à se rencontrer, dialoguer et rechercher ensemble un accord qui convienne à chacun.
L’intervention du manager n’a lieu qu’en dernier recours, si les échanges entre les parties ne permettent pas de résoudre la situation de manière satisfaisante.
L’élaboration d’outil de contrôle et de régulation du travail
Le management participatif laissant une grande autonomie aux collaborateurs, il convient donc que l’erreur est possible. Sans en tenir rigueur aux collaborateurs, l’encadrement doit mettre en place des indicateurs, des mesures de vérification qui permettront aux salariés de réaliser régulièrement des contrôles de leurs activités. Sont-ils sur la bonne voie ? Sont-ils dans les temps ?
Ces indicateurs peuvent être construits en collaboration avec les collaborateurs, tout comme ils participeront à l’élaboration des stratégies correctives pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.
A lire également :
- Management collaboratif : 10 bonnes pratiques pour le mettre en place
- La culture managériale en entreprise : un enjeu de taille
- Comment repérer et prévenir les mauvaises pratiques managériales ?
Le management participatif, pourquoi le mettre en place ? À qui s’adresse-t-il ?
Sur le papier, le management participatif semble ne présenter que des avantages tant pour l’entreprise que pour les collaborateurs. Pourtant, force est de constater que cette forme de management n’est pas majoritaire au sein de nos entreprises.
À quoi le devons-nous ? Le management participatif n’a-t-il que des avantages ? Est-il réservé qu’à certains types d’entreprise ?
Quels sont les avantages du management participatif ?
L’un des principaux avantages du management participatif, qui bénéficie à la fois aux collaborateurs et à l’entreprise, est celui de l’amélioration des conditions de travail.
Pour l’entreprise, cela lui permettra d’améliorer son attractivité et la fidélisation de ses collaborateurs et plus particulièrement ceux de la génération Z, mais aussi de limiter son taux d’absentéisme.
En étant davantage écoutés et en ayant la possibilité de choisir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, les collaborateurs gagnent en bien-être au travail. Cette satisfaction se traduit par une motivation renforcée dans la réalisation de leurs missions.
Le management participatif joue aussi un rôle dans la prévention des tensions. En impliquant les salariés dans l’organisation de leur quotidien et en les responsabilisant, il réduit les sources de frustration et contribue à maintenir un climat social stable.
Ce mode de gestion crée un environnement de travail plus serein, où les individus se sentent reconnus. Cela favorise la productivité individuelle, renforce la coopération entre collègues et stimule l’intelligence collective.
À terme, l’entreprise en tire un bénéfice global en matière de performance, enclenchant une dynamique positive.
Le management participatif, y a-t-il des inconvénients ? Quels sont les risques ?
Le concept de revers de la médaille s’applique également au management participatif, car si au premier abord il semble très attractif, ce mode de management demandera énormément d’effort et de temps.
En effet, arriver à un consensus n’est pas chose aisée et cela l’est encore moins lorsqu’il faut composer avec différentes populations.
Au sein d’une entreprise, nous trouvons non seulement des catégories professionnelles différentes, mais également des générations et des caractères différents. Dans ce contexte, parvenir à une décision commune peut s’avérer impossible ou presque.
Génération de frustrations, pertes de temps, augmentation des coûts seront alors autant de risques inhérents au management participatif.
L’un des inconvénients du management participatif tient également dans sa propension à créer des conflits. Cela peut apparaître contradictoire, puisqu’un management participatif contribue à limiter les conflits et à améliorer le climat social, mais lorsque le management participatif n’est pas conduit correctement et/ou si l’encadrement (plus particulièrement les managers) ne sont pas formés correctement à ce mode de management alors l’effet sera inverse.
Les conflits liés au management participatif peuvent trouver leurs origines dans diverses situations :
- Une reconnaissance systématique du travail collectif alors qu’il n’est l’œuvre que d’une poignée de personne. Engendrant ainsi frustrations, rancœur et manque de reconnaissance.
- Une mauvaise appréciation par l’encadrement de la gravité des conflits entre collaborateurs.
- Le fait de donner, consciemment ou non, régulièrement plus de poids à un avis plus qu’à un autre.
- …
L’un des derniers inconvénients du management participatif provient du risque de divulgation d’informations confidentielles.
Le management participatif pour tous, est-ce possible ?
Le management participatif demandant une grande autonomie dans l’organisation du travail (tant dans le temps de travail que dans la méthodologie), toutes les entreprises ne seront pas à même de l’intégrer dans leur mode de management.
Ainsi, le management participatif est plutôt réservé à des entreprises dont la productivité repose principalement sur la créativité et le produit intellectuel de ses collaborateurs.
En effet, il est difficilement envisageable de recourir à un management 100% participatif au sein d’une entreprise industrielle ou au sein d’une société de livraison, de restauration et autres qui nécessitent une satisfaction d’un besoin précis et tangible.
De même, tous les collaborateurs ne seront pas en recherche de ce mode de management. Au sein d’une start-up, composée de collaborateur de la génération Y et Z, le management participatif sera bien mieux accepté et compris qu’au sein d’une entreprise plus classique.
A lire également :
- Devenir manager : improvisation ou apprentissage ?
- Management : 11 leviers pour éliminer la procrastination.
- Management de la génération Y: 5 leviers pour réussir
Comment mettre en place le management participatif au sein de son organisation ?
Instaurer le management participatif au sein de son organisation peut demander du temps et un certain engagement de la part de la direction et de l’encadrement.
Afin qu’il soit couronné de succès, la mise en place du management participatif devra répondre au respect de certains principes.
Impliquer les collaborateurs à chaque étape du processus
L’un des grands principes du management participatif repose sur l’implication des salariés lors des grandes prises de décision : concertation sur la définition des axes stratégiques, détermination des objectifs de façon collégiale, délégation de la gestion des conflits, ….
Cette implication doit s’engager dès les prémices du management participatif. Ainsi, avant même de transformer le mode de management de votre organisation, intégrer les collaborateurs à cette étude.
Par le biais de groupe de travail, de sondage ou de tout autre moyen, assurez-vous que managers et subordonnés sont en accord avec ce mode de management et interrogez-les sur leurs attentes en ce qui concerne le management participatif.
Établir des règles claires et connues de tous
Pour que le management participatif soit efficace, il est nécessaire de rassembler l’ensemble des collaborateurs autour de repères communs, qu’il s’agisse de valeurs partagées ou de projets collectifs.
Cela passe notamment par la mise en place d’une charte définissant les engagements attendus et les règles de fonctionnement propres à cette approche managériale. Cette charte sert de référence au quotidien et facilite l’appropriation du cadre collectif.
Elle doit préciser les outils et méthodes de travail à adopter, les indicateurs permettant aux salariés d’évaluer leur progression, les procédures à suivre en cas d’absence ou de demande de congé, ou encore la manière dont les conflits seront gérés.
Ce cadre clair facilite l’autonomie tout en assurant une cohérence dans l’organisation.
Instaurez progressivement les conditions optimales du management participatif
Le management participatif nécessite une préparation structurée. Pour qu’il fonctionne, il faut introduire de nouvelles pratiques de travail, intégrer des outils adaptés et s’assurer que les collaborateurs disposent des soft skills nécessaires à ce mode d’organisation.
Les managers ont un rôle central dans cette transition. Il est donc essentiel de les former pour qu’ils puissent guider leurs équipes dans ce changement.
Apprendre à déléguer, encourager efficacement, maîtriser les outils collaboratifs ou encore développer une écoute active font partie des compétences clés à renforcer pour soutenir une démarche participative.
Mettez l’accent sur la communication
Multipliez les temps échanges et d’informations entre collaborateurs et entre collaborateurs et managers.
Que cela soit lors de la définition du fonctionnement du management participatif ou dans son exercice quotidien, il vous faudra emporter l’adhésion de votre personnel. Ainsi, la communication jouera un rôle central de cette mise en place.
Prenez le temps de leur expliquer les enjeux et avantages du management participatif, mais aussi quels peuvent être les risques d’une telle organisation. Informez-les sur leur nouveau rôle au sein de cette organisation et sur ce que vous allez attendre d’eux à présent.
Apprenez à déléguer et à limiter vos interventions après des collaborateurs
Déléguer n’est pas toujours évident, il faut avoir une juste mesure de la liberté accordée à ses collaborateurs afin qu’ils se sentent responsabilisés et non abandonnés par leur management.
De même, déléguer ne veut pas dire absence d’accompagnement et de mesure. Ainsi, déléguer ne s’improvise pas et vous devrez travailler en collaboration afin de déterminer ce qui fonctionne pour vos managers et collaborateurs.
Cela sera également valable lors de l’apparition de conflits au sein de vos équipes. Il vous faudra accepter de ne pas intervenir dans l’immédiat et leur accorder votre confiance dans la résolution de ces problèmes.