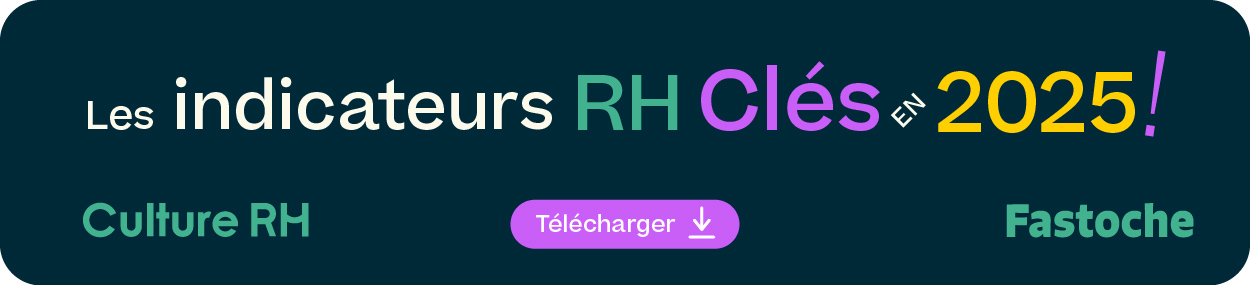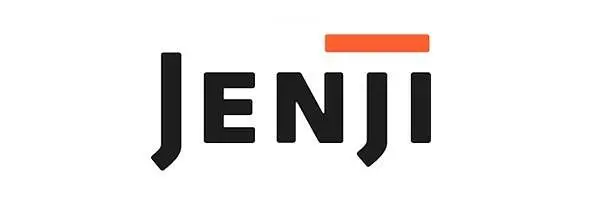Rémunération.
L’employeur ne peut modifier des objectifs fixés unilatéralement qu’en début d’exercice.
Cass. Soc. 8 avril 2021, n°19-15.432.
Le contrat de travail d’une salariée prévoyait une part variable en fonction d’objectifs régionaux collectifs et d’objectifs individuels fixés pour l’année.
La salariée saisit la juridiction prud’homale pour obtenir des rappels de salaire au motif que les objectifs étaient irréalistes et avaient été modifiés par l’employeur après le début de l’exercice.
Or, la Cour de cassation considère de manière constante que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation a jugé en l’espèce que, si l’employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d’exercice, et non en cours d’exécution alors qu’il prend connaissance de leur niveau d’exécution, ni à l’issue de l’exercice.
La Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, et retenu que l’employeur ne pouvait pas, à l’issue de l’exercice, unilatéralement, modifier le mode de calcul convenu de la rémunération, ni réduire le montant de la prime.
Licenciement.
1) L’acceptation de cadeaux d’un client peut justifier un licenciement pour faute grave.
Cass. Soc. 31 mars 2021, n°19-23.144.
Un salarié est embauché par une banque en qualité d’adjoint au chef d’agence puis de chef d’agence.
Il est licencié pour faute grave pour avoir bénéficié de cadeaux particulièrement importants de la part d’un client de l’agence qu’il dirigeait (cession d’un véhicule dont le salarié était le gérant et réalisation de travaux dans cinq de ses biens immobiliers le tout à titre gracieux).
Pourtant, le code de bonne conduite en vigueur dans l’entreprise interdisait l’acceptation de prêts, cadeaux, ou autres profits émanant de clients.
Le salarié conteste la validité de son licenciement devant les prud’hommes.
Si la Cour d’Appel, estimant que ces faits relèvent de sa vie privée, donne raison au salarié, la Cour de cassation ne statue pas dans ce sens. En effet, elle rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Or l’acceptation de cadeaux importants de la part d’un client est susceptible de caractériser un tel manquement, justifiant le licenciement du salarié pour faute grave, et en particulier, lorsqu’il existe au sein de l’entreprise un code de bonne conduite prohibant le comportement en cause.
À lire également :
- Actualités sociales mai 2021.
- Congés anticipés : Quelles sont les règles ?
- Remplacement des DIRECCTE par les DREETS au 1er avril 2021 : Tout savoir !
2) Est injustifié le licenciement d’un salarié refusant de rendre le véhicule de fonction constituant un avantage en nature.
Cass. Soc. 2 décembre 2020 n° 19-18445.
Un salarié est engagé en août 2007 en qualité de responsable technique et se fait attribuer un véhicule de fonction. En décembre 2014, l’employeur l’informe de sa décision de supprimer la mise à disposition de son véhicule de fonction à compter de janvier 2015, et lui précise que la valeur de l’avantage en nature serait intégrée à la rémunération brute mensuelle.
ROI Formation : enjeux, calcul et optimisation en 2025
Alors que les budgets se resserrent, 1 DRH sur 2 peine à démontrer l'efficacité des actions de formation. Pourtant, il existe des méthodes concrètes pour prouver leur retour sur investissement. Dans ce livre blanc, Culture RH décrypte les bons indicateurs à suivre, les pièges à éviter et les étapes clés pour calculer efficacement le ROI de vos actions de formation.
Je téléchargeLe salarié refuse de restituer son véhicule de fonction considérant qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail.
L’employeur décide de licencier le salarié pour faute grave en raison de la contestation du pouvoir de l’employeur.
Le salarié saisit alors les prud’hommes pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.
La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et donne raison au salarié. Elle rappelle, d’une part, que :
- Les avantages en nature constituent un élément de rémunération et que le fait pour l’employeur d’en priver le salarié constitue une réelle modification du contrat de travail.
- « Est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un salarié ayant refusé de restituer, non un véhicule de service, mais le véhicule de fonction dont il a la disposition depuis plusieurs années et qui constitue un avantage en nature ».
D’autre part, elle reprécise la différence entre « une modification du contrat de travail » que le salarié est en droit de refuser sans pouvoir être sanctionné et « une modification des conditions d’exécution du contrat de travail » qui s’impose au salarié et dont le refus peut entraîner une sanction.
Sanction disciplinaire.

L’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction … ».
Cass.Soc.14 avril 2021 n°475.
Un salarié est engagé en qualité de responsable atelier imprimerie d’une compagnie ferroviaire. L’employeur lui notifie, sous réserve de son acceptation, une rétrogradation disciplinaire à un poste de bibliothécaire à un coefficient et une rémunération inférieurs à son poste précédent. Un avenant au contrat de travail est signé, en ce sens, par les parties.
Le salarié saisit la juridiction de Prud’hommes en annulation de cette sanction et rétablissement sous astreinte dans un poste de qualification et rémunération équivalentes à son précédent emploi.
Il résulte de cet arrêt que l’acceptation d’une rétrogradation via la signature d’un avenant au contrat ne protège pas l’employeur de toute contestation ultérieure. En effet, le salarié peut, suite à la signature d’un avenant à son contrat de travail, contester le bien-fondé de la sanction devant la juridiction prud’hommale afin d’en obtenir l’annulation. C’est d’ailleurs la solution qui a été retenue dans cette affaire par le Conseil de Prud’hommes, qui a annulé la rétrogradation contestée.
À lire également :
- Le nouveau congé de paternité et de l’accueil de l’enfant au 1er juillet 2021.
- Décision unilatérale de l’employeur (DUE) et mutuelle d’entreprise : Comment ça marche ?
- Négociation d’un accord d’intéressement : Comment faire ?
Discrimination.
L’atteinte à l’image commerciale ne justifie pas l’interdiction de port du voile au sein d’une entreprise.
L’absence de toute clause de neutralité rend automatiquement nul tout licenciement fondé sur le port d’un tel signe religieux.
Cass.Soc. 14 avril 2021, n°19-24.079.
Une salariée, engagée comme vendeuse, se présente à son poste de travail, à l’issue d’un congé parental, avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. L’employeur lui demande de retirer son foulard et, suite au refus de la salariée, la place en dispense d’activité puis la licencie pour cause réelle et sérieuse trois mois plus tard.
S’estimant victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses, la salariée saisit la juridiction prud’hommale d’une demande en nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.
La Cour d’Appel fait droit à la demande de la salariée.
D’une part, elle note l’absence d’une clause de neutralité dans le règlement intérieur ou dans une note de service aux mêmes dispositions que le règlement intérieur.
D’autre part, elle rejette l’argument de l’employeur selon lequel le refus de port du foulard repose sur une exigence professionnelle essentielle fondée sur la nature de l’emploi de vendeuse, emploi impliquant un contact avec la clientèle, et sur « la nature de l’activité de l’entreprise, son image de marque et son choix de positionnement commercial ». Au contraire, elle juge que l’image commerciale que souhaite projeter l’employeur ne peut pas constituer un objectif légitime justifiant cette interdiction.
La Cour de cassation, devant laquelle l’affaire est portée, confirme la position de la Cour d’Appel et réaffirme que
- Les restrictions portées à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle déterminante et être proportionnées au but recherché.
- Le règlement intérieur d’une entreprise peut prévoir une clause de neutralité, laquelle permet d’interdire aux salariés le port de tout signe religieux, politique ou philosophique, notamment lorsqu’ils sont en contact avec la clientèle.
Par ailleurs, elle ajoute que, même si l’employeur est en mesure de démontrer que l’interdiction de port d’un signe religieux distinctif repose sur une exigence professionnelle essentielle, déterminante, proportionnée et poursuivant un objet légitime, l’absence de toute clause de neutralité rend automatiquement nul tout licenciement fondé sur le port d’un tel signe religieux.
Il est à noter cependant que, par un arrêt du 8 juillet 2020, (n°18-23743), La Cour de cassation avait déjà précisé que, si la restriction du port d’un signe religieux ne figurait pas dans le règlement intérieur, elle n’était possible que s’il existait une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » au sens de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.
Enfin, en l’espèce, La Cour de cassation précise que « l’attente des clients sur l’apparence physique des vendeuses » ne peut pas constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante et que, par conséquent, comme elle l’a affirmé dans l’arrêt de 8 juillet 2020, (n°18-23.747), seul un risque d’hygiène et/ou de sécurité pourrait, le cas échéant, justifier une restriction au port de signes religieux.
À lire également :
- Prime Macron 2021 : Qui peut en bénéficier ? Quel montant ? Comment la traiter en paie ?
- Le suivi médical des salariés en entreprise : Tout savoir !
- Négociations annuelles obligatoires (NAO) : Pour qui ? Comment ? Durée des accords ? Tout savoir !
Congés.
La possibilité octroyée aux entreprises, durant la crise du Covid-19, d’imposer aux salariés la prise de jours de congé ou de repos, ne se justifierait qu’en présence de difficultés économiques.
CA Paris, 1er avril 2021, RG n° 20/12215.
Un groupe industriel impose à ses salariés ne pouvant télétravailler la prise de 10 jours de congé dans le cadre du dispositif prévu par les articles 2 et 4 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos. Un syndicat introduit en référé une action en annulation des jours de congé imposés devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Débouté par le Tribunal, le syndicat fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, qui vient de juger que cet employeur ne pouvait pas imposer les dates de congés à ses salariés dans le cadre du dispositif prévu par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, qui « prévoit expressément et clairement que la prise de mesures dérogatoires ne peut intervenir que lorsque que l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation du virus Covid-19 et qu’il appartient aux sociétés du Groupe (…) de rapporter la preuve des difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19. En l’espèce, selon les juges de la Cour d’Appel, ces difficultés ne sont pas caractérisées par les simples mesures d’adaptation mise en avant par le groupe (nécessité d’aménager les espaces de travail et d’adapter le taux d’occupation des locaux en raison des conditions sanitaires).
Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision controversée.
À ce jour, il existe donc une incertitude quant à la nécessité pour un employeur qui envisage d’imposer aux salariés de prendre certains jours de repos, de démontrer les difficultés économiques qui l’y conduisent.