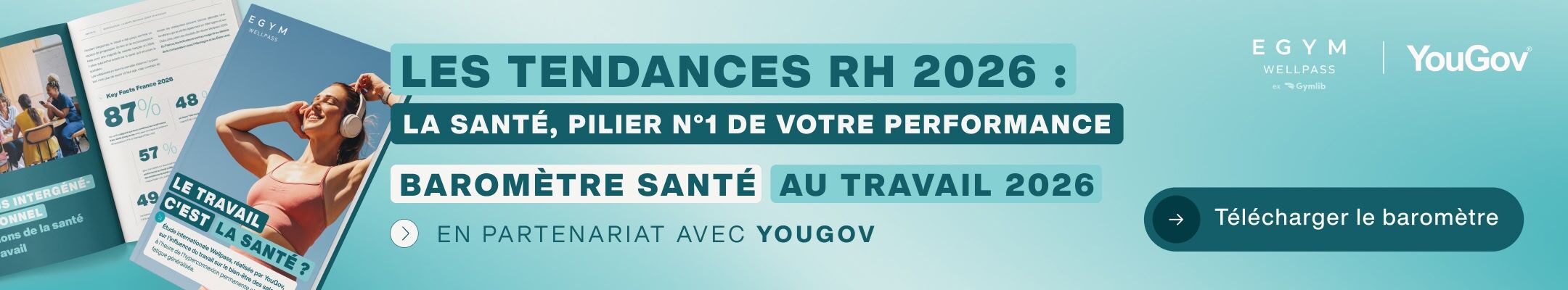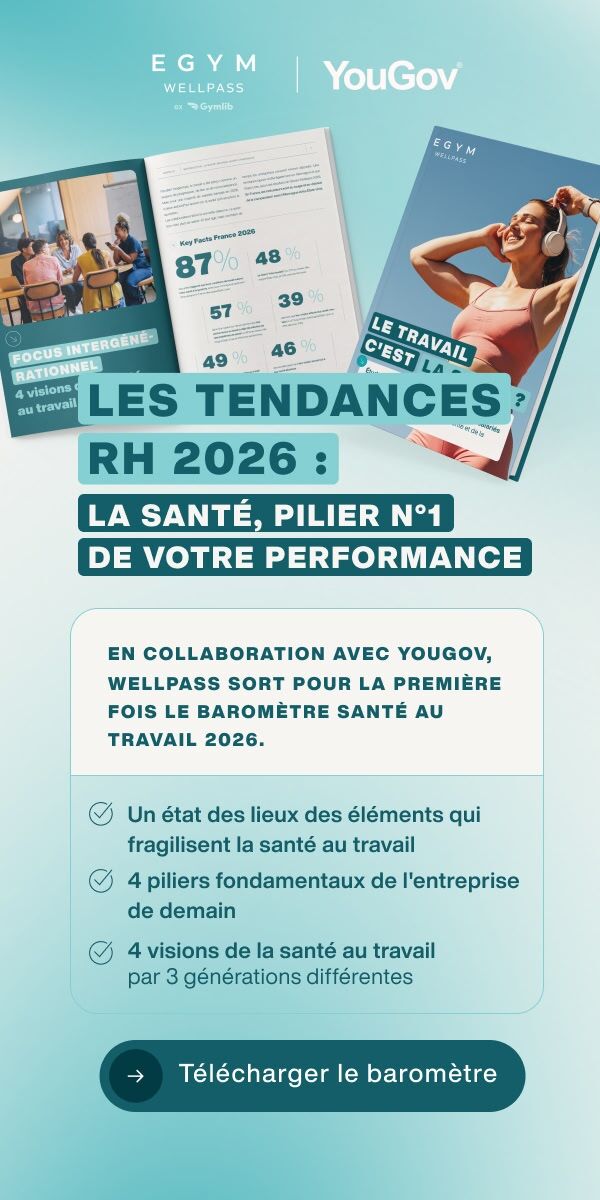47% des salariés déclarent avoir déjà travaillé moins efficacement à cause de leur état de santé mentale. Ce chiffre, tiré du Baromètre 2025 sur la santé mentale au travail, révèle l’ampleur d’un phénomène qui ne se cache plus.
Selon l’étude Qualisocial, un salarié sur quatre estime aujourd’hui avoir une mauvaise santé mentale, et cette proportion grimpe à 29% chez les femmes.
Pourtant, avant qu’un collaborateur ne s’effondre ou ne dépose un arrêt maladie, des signaux discrets apparaissent. Ces “signaux faibles” changements subtils de comportement, variations d’humeur, modifications des habitudes de travail constituent autant d’indices précieux pour qui sait les détecter.
Conscientes de leur responsabilité légale depuis l’article L. 4121-1 du Code du travail, mais aussi de l’urgence humaine et économique de la situation, les équipes RH développent progressivement leurs capacités de détection précoce.
Elles ne partent pas de zéro : EDF forme ses managers à repérer les signaux de détresse, Orange mise sur la bienveillance managériale, tandis que BNP Paribas déploie des outils digitaux sophistiqués.
Dans ce contexte où la santé mentale est Grande Cause Nationale 2025, comment les professionnels RH affûtent-ils leur regard ? Quels outils pratiques utilisent-ils sur le terrain ? Et surtout, comment passer de l’observation à l’action sans franchir les lignes de l’intrusion ?
A lire également :
- RPS : comment établir le diagnostic de son entreprise ?
- Tendances RPS 2025 : les 5 tendances à suivre cette année
- RPS : quelles sont les obligations de l’employeur ? Comment les détecter ? Les prévenir ?
Les signaux faibles : un langage à décrypter
La détresse psychologique ne surgit pas du jour au lendemain. Elle s’installe progressivement, laissant derrière elle une constellation d’indices que les spécialistes qualifient de “signaux faibles”.
Ces manifestations, souvent imperceptibles au premier regard, forment un véritable langage corporel et comportemental qu’il faut apprendre à lire.
Les manifestations émotionnelles arrivent généralement en premier. Un collaborateur habituellement jovial devient irritable sans raison apparente. Les sautes d’humeur se multiplient, alternant entre anxiété palpable et moral en berne. Parfois, ce sont des crises de larmes inattendues qui alertent l’entourage professionnel.
Puis viennent les signaux physiques, plus visibles mais souvent banalisés : troubles du sommeil qui se lisent sur un visage fatigué, maux de tête récurrents, douleurs musculaires inexpliquées.
Simplifiez votre reporting RH
Vous voulez optimiser votre gestion RH ? Suivez les bons indicateurs pour améliorer votre prise de décision. Ce livre blanc de notre partenaire les Éditions Tissot vous permet de structurer vos échanges avec la direction, les managers et les représentants du personnel.
Je télécharge gratuitementUn collaborateur peut développer des troubles digestifs, des palpitations ou simplement afficher cette fatigue chronique que même un week-end ne parvient plus à dissiper.
Sur le plan cognitif, les changements deviennent préoccupants. Les difficultés de concentration s’accentuent, les erreurs se multiplient, parfois chez des personnes habituellement irréprochables. La prise de décision devient laborieuse, les oublis s’accumulent.
Les transformations comportementales marquent souvent un tournant. Le repli sur soi s’amorce : moins de participation aux réunions, évitement des pauses café, désengagement progressif des projets collectifs. L’absentéisme augmente, les retards se répètent.
Paradoxalement, certains salariés font l’inverse : ils s’acharnent au travail, restent tard sans efficacité réelle, dans une fuite en avant révélatrice.
Les professionnels de la prévention distinguent trois niveaux d’alerte progressifs.
- D’abord l’alerte : baisse d’engagement, quelques erreurs inhabituelles.
- Puis l’alarme : isolement marqué, irritabilité constante, conflits avec les collègues.
- Enfin la crise : absentéisme important, cynisme, et dans les cas les plus graves, verbalisation de pensées suicidaires.
Cette gradation explique pourquoi la détection précoce s’avère cruciale. Intervenir au niveau “alerte” permet d’éviter l’escalade vers des situations de crise bien plus complexes à gérer, tant pour le salarié que pour l’organisation.
Les RH développent leurs “radars” : méthodes et outils
Face à cette réalité, les équipes RH ne peuvent plus se contenter d’attendre les signalements. Elles développent méthodiquement leurs capacités de détection, combinant observation humaine et analyse de données pour créer de véritables “radars” de la santé mentale.
La formation des managers constitue le premier pilier. Ces derniers, en première ligne avec les équipes, deviennent les capteurs essentiels du dispositif.
Cette formation ne se limite pas à une sensibilisation théorique : elle inclut des mises en situation pratiques pour apprendre à reconnaître les changements subtils de comportement, l’irritabilité inhabituelle ou le désengagement progressif des collaborateurs.
L’exploitation intelligente des données SIRH révolutionne l’approche traditionnelle. Les systèmes analysent désormais automatiquement les patterns d’absentéisme, les demandes de congés inhabituelles, l’accumulation d’heures supplémentaires ou les changements dans les évaluations de performance.
Certaines plateformes génèrent même des alertes lorsque plusieurs indicateurs se dégradent simultanément chez un même collaborateur.
Les enquêtes de bien-être se démocratisent mais évoluent vers plus de finesse. Exit les questionnaires annuels généralistes : place aux sondages courts, réguliers, parfois hebdomadaires.
Quelques questions ciblées permettent de mesurer l’évolution du moral, de détecter les pics de stress ou d’identifier les équipes sous tension. L’anonymat reste garanti, mais les analyses permettent de repérer les zones à risque.
Les outils digitaux dédiés à la QVT gagnent du terrain dans les grandes structures. Applications de suivi émotionnel, bilans flash sur l’état mental, chatbots d’accompagnement…
Ces solutions permettent aux salariés de s’exprimer librement tout en offrant aux RH une vision temps réel des tendances.
L’avantage réside dans la possibilité pour les collaborateurs de signaler leur mal-être sans avoir à franchir physiquement la barrière du bureau RH.
La création d’espaces de parole reste fondamentale. Entretiens individuels renforcés, réunions d’équipe centrées sur le ressenti, dispositifs d’écoute internes…
L’objectif : libérer la parole avant que les difficultés ne s’enracinent. Ces moments d’échange révèlent souvent des tensions organisationnelles invisibles depuis les bureaux de direction.
Cette approche multicapteurs transforme le rôle des RH : d’une posture réactive face aux crises déclarées, elles passent à une démarche proactive de veille sanitaire permanente.

Sur le terrain : comment EDF, Orange et BNP Paribas s’y prennent
Les grandes entreprises françaises ne se contentent plus de déclarations d’intention. Elles déploient des stratégies concrètes, chacune adaptée à sa culture et ses contraintes sectorielles.
EDF mise sur une approche globale de prévention des risques psychosociaux.
L’énergéticien a développé un plan complet qui articule plusieurs leviers : formations approfondies des managers pour qu’ils sachent identifier les signaux de détresse chez leurs collaborateurs, mise en place de dispositifs de soutien psychologique accessibles à tous les salariés, et surtout, sensibilisation de l’ensemble des équipes aux enjeux de santé mentale.
Cette démarche s’inscrit dans une politique plus large de qualité de vie au travail qui vise à créer un environnement où l’expression des difficultés devient naturelle.
Chez BNP Paribas, la révolution passe par le digital. La banque a fait le pari des outils technologiques pour détecter précocement les signaux faibles.
Des plateformes dédiées permettent de recueillir en continu le ressenti des collaborateurs, d’analyser les tendances et de détecter automatiquement les situations à risque.
Ces systèmes s’accompagnent d’un accompagnement personnalisé : lorsque des signaux d’alerte remontent, les équipes RH peuvent rapidement orienter les salariés vers les ressources d’aide appropriées. Cette approche data-driven permet une prévention active et ciblée.
Orange privilégie la transformation managériale. L’opérateur télécom a concentré ses efforts sur l’amélioration de la qualité de vie au travail à travers deux axes principaux. D’une part, une flexibilité renforcée : télétravail facilité, horaires aménagés, réorganisation des tâches pour limiter la pression.
D’autre part, une formation managériale intensive axée sur la bienveillance et la prévention du burnout. Les managers apprennent à déceler les signes de fatigue mentale, à adapter leur style de management et à créer un climat de confiance propice aux échanges sur les difficultés personnelles.
La Poste et la SNCF ont rejoint le mouvement en s’engageant dans la Grande Cause Nationale 2025. Ces entreprises de service public développent des actions concrètes de sensibilisation, organisent des ateliers collectifs de prévention et mettent en place des dispositifs d’écoute spécifiques.
Leur objectif : lever les tabous qui persistent encore autour de la santé mentale dans les secteurs traditionnels.
Ces expériences révèlent trois facteurs de succès communs :
- D’abord, l’engagement visible de la direction qui donne une légitimité aux actions menées.
- Ensuite, l’articulation entre approches technologiques et humaines : les outils digitaux complètent, mais ne remplacent pas le contact direct.
- Enfin, la prise en compte des spécificités sectorielles : une banque n’aura pas les mêmes enjeux qu’un opérateur de transport ou qu’un énergéticien.
Plus révélateur encore : ces entreprises constatent des résultats mesurables. Réduction de l’absentéisme, amélioration des indicateurs de bien-être, meilleure fidélisation des talents. La prévention de la santé mentale devient ainsi un levier de performance autant qu’un impératif éthique.
Construire sa stratégie de détection : les étapes clés
Pour les entreprises qui souhaitent développer leur propre dispositif, quelques étapes structurantes émergent des pratiques les plus abouties.
L’évaluation des risques psychosociaux constitue le préalable indispensable. Conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail, cette analyse doit être consignée dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), mis à jour annuellement.
Cette obligation légale devient l’opportunité d’identifier les facteurs de stress spécifiques à chaque métier, équipe ou site. Charge de travail, relations interpersonnelles, organisation du temps, autonomie… Chaque contexte révèle ses propres zones de fragilité.
La formation des acteurs clés suit naturellement. Managers de proximité, référents RH, membres du Comité Social et Économique : tous doivent acquérir les bases de la détection des signaux faibles.
Cette montée en compétences s’accompagne de la définition de protocoles clairs : qui contacter ? Comment réagir ? Quelles sont les limites de l’intervention managériale ?
Le déploiement des outils de suivi peut alors commencer, en partant du plus simple vers le plus sophistiqué. Enquêtes de climat social, exploitation des données RH existantes, puis progressivement outils digitaux spécialisés selon les besoins et les budgets.
L’important : garantir l’anonymat et la confidentialité pour encourager l’expression authentique.
La culture de la transparence représente peut-être le chantier le plus délicat. Il s’agit de créer un environnement où parler de ses difficultés psychologiques ne constitue plus un tabou professionnel.
Campagnes de communication, témoignages de collaborateurs, formation de personnes ressources internes… Cette transformation culturelle prend du temps, mais conditionne l’efficacité de tous les autres dispositifs.
Les entreprises les plus avancées le confirment : la détection des signaux faibles n’est pas une fin en soi, mais un moyen de construire des organisations plus humaines et, paradoxalement, plus performantes.
Dans un contexte où 39% des salariés n’ont pas accès à des mesures de prévention santé mentale, celles qui s’engagent sérieusement dans cette voie prennent une longueur d’avance décisive.
A lire également :
- Le burnout chez les profils atypiques : comprendre et prévenir
- Retour suite à une longue absence : comment le préparer ? L’exemple du congé de maternité
- Télétravail : Comment prévenir les risques psychosociaux ?