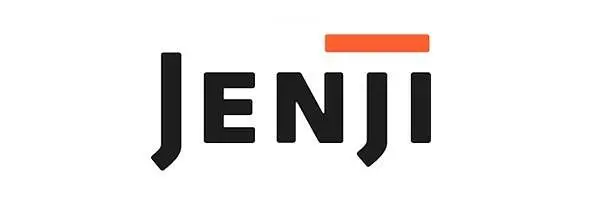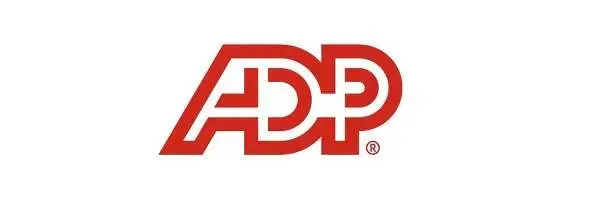Les congés payés doivent être soldés avant la date de fin de la période de référence, qui est généralement fixée au 31 mai, sauf autres dates de prise fixées dans l’entreprise.
Cependant, lorsque les congés ne sont pas soldés à temps, trois issues sont envisageables selon la situation : ils peuvent être perdus, faire l’objet d’un report si les conditions le permettent, ou être indemnisés sous forme d’une indemnité compensatrice.
Mais dans quels cas ce paiement est-il autorisé ? Quels sont les recours pour ne pas perdre ses congés payés ? Et quelles sont les règles à connaître pour bien calculer l’indemnité compensatrice de congés payés ?
Cet article vous propose un tour d’horizon complet sur les règles en matière de paiement des congés payés.
Paiement des congés payés non pris : dans quels cas est-ce possible ?
Dans certains cas, les congés payés non pris à la fin de la période de référence de prise peuvent être payés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Départ du salarié
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, quel que soit le motif de rupture (licenciement, démission, rupture conventionnelle, fin de CDD, décès, etc), il a droit au paiement de ses congés payés non pris sous forme d’une indemnité compensatrice.
Par exemple, un salarié en CDI qui démissionne en septembre sans avoir pris ses jours restants à prendre avant le 31/05 N+1 et ses congés en cours d’acquisition, les percevra sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés.
C’est également la cas des salariés en fin de CDD, y compris les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation. En cas de décès, l’indemnité est versée aux ayants droit du salarié.
Les congés payés de la période antérieure qui ont été reportés sur la période de référence en cours avec l’accord de l’employeur, ou de droit en cas d’absence, donnent également lieu à une indemnité compensatrice s’ils n’ont pas été pris.
Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2007 (pourvoi n° 0641744).
Congés non pris en raison de l’employeur
Lorsque l’organisation du travail empêche le salarié de prendre ses congés, il peut demander le paiement d’une indemnité compensatrice. Cela peut se produire notamment dans les situations suivantes :
- L’employeur oppose plusieurs refus de congés sans justification valable.
- Le salarié occupe un poste à responsabilité avec une surcharge d’activité chronique.
- Le service fonctionne en sous-effectif permanent, ne permettant pas la prise effective des congés.
En revanche, un salarié qui n’a pas posé ses congés alors qu’il en avait la possibilité ne peut pas exiger leur paiement. Il peut toutefois demander un report, mais si l’employeur le refuse, les congés sont alors perdus.
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-17723) que c’est à l’employeur de prouver qu’il a bien rempli ses obligations en matière de prise des congés.
Si un salarié n’a pas pu prendre ses jours de congés et en réclame le paiement, l’employeur doit être en mesure de démontrer qu’il lui a effectivement permis d’exercer son droit à congé.
À défaut de cette preuve, il peut être condamné à payer l’indemnité compensatrice correspondante.
Impossibilité de prendre ses congés en cas d’absence
La législation prévoit la possibilité d’un report des congés payés lorsque le salarié n’a pas pu les solder en raison d’une absence de longue durée. Il s’agit notamment :
- Du congé de maternité ou d’adoption.
- Du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
- Du congé parental d’éducation à temps plein.
- Du congé de solidarité familiale.
- Du congé de présence parentale pour enfant malade.
- Du congé de proche aidant.
Lorsque le salarié reprend le travail, ses congés payés sont reportés. Il doit alors les prendre, généralement avant sa reprise effective dans l’entreprise.
Toutefois, ces congés reportés ne peuvent pas être payées au salarié, sauf si l’employeur empêche le salarié de les poser malgré sa demande, ou si le salarié quitte définitivement l’entreprise.
Le report de congés en cas d’arrêt de travail depuis la loi du 22 avril 2024
Depuis la loi du 22 avril 2024, les arrêts pour accident ou maladie non professionnels ouvrent droit désormais à l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition.
Toutefois, des dispositions plus favorables pour le salarié peuvent s’appliquer dans l’entreprise, comme un maintien de l’acquisition des congés payés tant que la rémunération est maintenue.
A lire également :
- Journée de solidarité : qu’est-ce que c’est ? Comment la traiter en paie ?
- Comment calculer la provision pour congés payés en 2026 ?
- Subrogation & congés: comment fonctionne l’indemnisation ?
Par ailleurs, lorsque l’accident ou la maladie est d’origine professionnelle, l’acquisition est de 2,5 jours de congés par mois, comme pour les salariés présents dans l’entreprise, sans limitation de durée.
Ainsi, les salariés concernés peuvent bénéficier d’un report de leurs congés dans un délai de 15 mois suivant la reprise, sous réserve d’avoir été informés de leurs droits.
Pour autant, ces congés ne peuvent pas être indemnisés au retour du salarié. Ils doivent impérativement être pris dans les délais impartis, sous peine d’être perdus.
Comme pour les salariés en congés avec des reports de droit (maternité, paternité, etc.), les congés doivent être pris et ne peuvent pas être indemnisés sauf en cas d’impossibilité de les prendre du fait de l’employeur ou départ définitif du salarié.
Congés non pris : Quelle sont les possibilités pour ne pas perdre ses congés ?
En dehors des cas prévus par la réglementation concernant le paiement ou le report des congés payés, les salariés qui n’ont pas pu solder tous leurs congés à la date limite de prise (par exemple au 31 mai dans de nombreuses entreprises) ne peuvent pas prétendre à une indemnité compensatrice.
Toutefois, plusieurs possibilités existent pour éviter la perte de ces jours de congés :
Mutuelle d'entreprise : Le guide pratique pour optimiser son contrat et en faire un vrai levier RH
Hausse des cotisations, réglementation floue, salariés perdus dans leurs garanties… Votre mutuelle d'entreprise mérite mieux qu'une simple obligation administrative ! Découvrez le guide pratique de notre partenaire Mūcho, pour transformer ce poste de coût en véritable atout RH : optimisation des contrats, communication auprès des équipes, et conseils terrain pour les PME.
Je télécharge le guide gratuit- Demander un report à son employeur : Ce report reste soumis à l’accord de l’employeur, qui peut légitimement le refuser.
- Placer ces jours sur un compte épargne temps (CET) : Seuls les congés correspondant à la 5ᵉ semaine, les congés de fractionnement et les congés conventionnels (congés d’ancienneté, de sujétion, etc.) peuvent être placés sur un CET.
Indemnité compensatrice de congés payés : Comment la calculer ?
Lorsque le salarié quitte l’entreprise ou en cas d’impossibilité de prendre ses conges payés avant la fin de période de prise imputable à l’employeur, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Méthode du maintien de salaire ou du dixième
L’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) se calcule selon le montant le plus favorable au salarié entre deux méthodes :
- Méthode du dixième : 10 % de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (base congés payés), divisée par le nombre de jours de congés légaux acquis.
- Méthode du maintien de salaire : Le salaire mensuel divisé par 26 jours ouvrables ou par 21,67 (ou 22) jours ouvrés.
Le taux journalier le plus favorable entre ces deux méthodes est alors multiplié par le nombre de jours de congés non pris.
Bien calculer la base de congés payés
Pour bien calculer l’ICCP, il est essentiel de bien déterminer la base de congés payés. L’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés comporte le salaire de base et ses compléments à partir du moment où ils rémunèrent une période travaillée.
Ainsi, peuvent être prises en compte les primes régulières, les heures supplémentaires ou encore les avantages en nature. En revanche, les primes exceptionnelles ou celles versées indépendamment du temps de travail effectif sont exclues de l’assiette de calcul.
De cette façon, une prime de 13ème mois n’est pas prise en compte à partir du moment où la prime est versée, période de présence et congés confondus, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de proratisation de la prime lorsque le salarié est en congés payés. Dans le cas contraire, elle peut alors être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’ICCP.
En ce qui concerne les périodes d’absence, certains congés légaux (maternité, paternité, adoption) ainsi que les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés : la rémunération qui aurait été perçue doit donc être prise en compte comme si le salarié avait travaillé.
Pour les arrêts de travail d’origine non professionnelle, seuls 80 % du salaire habituel doivent être intégrés, conformément à la loi du 22 avril 2024, en cohérence avec l’acquisition de 2 jours ouvrables par mois.
L’indemnité compensatrice de congés payés sur le bulletin de salaire
L’indemnité compensatrice de congés payés doit apparaître de manière distincte sur le bulletin de paie. Figure généralement le nombre de jours soldés, le taux journalier appliqué ainsi le montant brut versé en deux lignes distinctes : les congés acquis et les congés e cours d’acquisition.
Exemple de mention sur le bulletin de salaire :
| Libellé | Nombre | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Indemnité compensatrice congés en cours d’acquisition | 20 | 103,84 | 2076,80 € |
| Indemnité compensatrice congés acquis | 6 | 100 | 600 € |
Comme les autres éléments de rémunération ayant la caractère de salaire, l’indemnité compensatrice de congés payés est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
A lire également :
- Annulation de congés : quelles sont les règles ? Délais ?
- Refus de congés par l’employeur : quelles règles ?
- Calcul du préavis de démission : dispense, traitement paie, …Tout savoir !