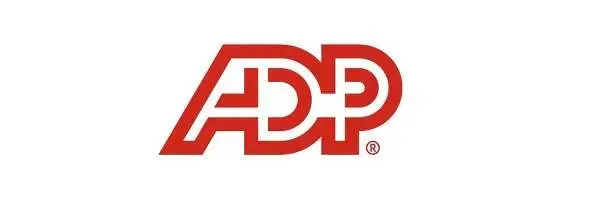Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat temporaire qui ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
Le chômage après une période de CDD est encadré, lui aussi, par des règles et des conditions précises, différentes selon que le CDD est arrivé à échéance ou qu’il est rompu de manière anticipée.
Quelles sont les règles selon les différents cas de rupture du CDD ? Quelles sont les conditions d’ouverture des droits au chômage ? Quelles sont les dernières évolutions législatives ?
Les différents cas de rupture du CDD
Le principe de perte involontaire d’emploi
La règlementation de l’assurance chômage applique le principe de perte involontaire d’emploi, condition première pour l’ouverture des droits au chômage.
La fin du CDD est généralement assimilée à une perte involontaire d’emploi, permettant au salarié de bénéficier des allocations chômage.
Il convient cependant de distinguer les différents cas de rupture de CDD car, selon le mode de rupture du CDD, le principe de perte involontaire d’emploi ne peut pas toujours s’appliquer.
Les différents cas de rupture du CDD
Quatre modes de rupture doivent être distingués :
Le chômage après un CDD arrivé à terme
La fin du contrat à durée déterminée prenant effet au terme du contrat est constitutive d’une situation de chômage involontaire qui permet l’ouverture d’un droit à l’Assurance chômage.
C’est la situation la plus fréquente. En effet, à la fin du CDD, la loi considère que le salarié a été privé de son emploi de manière involontaire, même s’il est possible que sa situation résulte de son refus à renouveler son CDD.
Le salarié est assimilé à un salarié en CDI licencié et bénéficie à ce titre de l’allocation chômage.
Que se passe-t-il en cas de refus d’un CDI à l’issue du CDD ?
Depuis le 1er janvier 2025, un salarié qui refuse, à l’issue de son CDD ou de sa mission d’intérim, deux propositions de CDI considérées comme « identiques et similaires » dans les 12 mois précédant la fin du contrat, s’expose à la perte de ses droits au chômage.
Cette privation n’est cependant pas automatique. La proposition de CDI doit impérativement respecter plusieurs conditions cumulatives, fixées par les articles L.1243-11-1 et L.1251-33-1 du Code du travail.
Cette règle ne s’applique pas si :
- Le salarié a travaillé en CDI au cours de la même période.
- Si les propositions faites par l’employeur ne respectent pas son projet personnalisé d’accès à l’emploi.
La rupture d’un commun accord entre l’employeur et le salarié
La rupture anticipée d’un CDD, d’un commun accord, est assimilée à une perte involontaire et ouvre droit au chômage après un CDD.
Le chômage après un CDD rompu à l’initiative de l’employeur
La rupture anticipée du CDD par l’employeur n’est possible que dans trois situations prévues par la loi :
- La faute grave ou lourde du salarié.
- La force majeure.
- L’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture du CDD à l’initiative de l’employeur, avant le terme du contrat, quelle qu’en soit la raison, place le salarié en situation de chômage involontaire et pourra le faire bénéficier d’un droit à l’Assurance chômage.
Le chômage après un CDD rompu à l’initiative du salarié
Le salarié peut légalement rompre son CDD de manière unilatérale :
- Avant la fin de la période d’essai.
- Si une faute grave est commise par l’employeur.
- S’il bénéficie d’une embauche en CDI.
Mais seule la rupture du CDD en raison de la faute grave de l’employeur, reconnue comme telle par le Conseil des Prud’hommes, ouvre droit aux allocations chômage.
En effet, cette rupture est alors assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à l’ARE.
Les deux autres motifs de rupture sont assimilés à une démission qui ne donne pas droit, a priori, au bénéfice de l’allocation chômage puisque c’est le salarié qui est à l’initiative de cette rupture, se mettant ainsi en situation de chômage volontaire.
Cependant, dans certaines situations, il est possible d’être indemnisé par France Travail suite à une démission. C’est le cas de la démission légitime qui ouvre droit au chômage après un CDD, notamment lorsque :
- Le salarié est contraint de déménager :
- pour résider avec son conjoint ou son partenaire PACS ou suivre ce dernier dans le cadre d’une mobilité professionnelle ;
- pour suivre ses parents dans le cas d’un travailleur mineur (apprenti par exemple) ;
- pour suivre son tuteur, curateur ou mandataire dans le cas d’un travailleur majeur « protégé », car placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
- Le salarié ou l’entreprise est confronté à un cas de force majeure.
- Le médecin du travail a constaté une inaptitude du salarié à l’exercice de sa profession.
- Le salarié ou l’employeur a commis une faute grave comme le non-paiement de salaire malgré une décision de justice.
- Le salarié a signé un contrat de service civique, ou de volontariat de solidarité internationale, ou de volontariat associatif d’une durée minimale d’un an.
- Le salarié est en fin de contrat unique d’insertion pour un CDD d’au moins 6 mois en vue de suivre une formation qualifiante.
Le salarié est tenu de fournir les preuves étayant ses affirmations lors de son inscription à Pôle Emploi. Le versement commence au lendemain de la rupture du contrat.
En dehors de ces cas, le salarié démissionnaire perd non seulement son droit à une indemnisation pour perte d’emploi, mais il peut en plus être redevable de dommages et intérêts à son employeur pour rupture anticipée du CDD.
A lire également :
- Chômage partiel : comment le traiter en paie ?
- Mise à pied disciplinaire : règles, procédure, modèle de lettre… tout savoir !
- Refus de rupture conventionnelle par l’employeur : quels motifs légitimes ? Comment les traiter ?
Les conditions d’ouverture des droits au chômage après un CDD
Lorsque le salarié a perdu son emploi de manière involontaire, ou a démissionné pour un motif considéré comme légitime, il doit encore respecter plusieurs autres conditions pour pouvoir bénéficier des allocations chômage :
Une durée minimale de travail
Pour bénéficier du chômage, le salarié doit avoir travaillé durant une période minimale de 6 mois, soit 130 jours ou 910 heures, dans les 24 mois précédant la fin du contrat de travail.
Pour les salariés de 55 ans et plus à la date de fin du dernier contrat, la période minimale de travail doit avoir été effectuée au cours des 36 derniers mois.
Depuis le 1er avril 2025, un travailleur saisonnier peut bénéficier d’une allocation chômage s’il justifie de 5 mois travaillés au cours des 24 derniers mois, exclusivement au titre de contrats saisonniers (soit 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées).
Cette condition peut être remplie avec un ou plusieurs contrats chez différents employeurs.
Cette durée de travail peut résulter de plusieurs CDD successifs, de missions d’intérim, ou de périodes de travail à temps partiel.
Toutes les périodes se cumulent : un salarié ayant travaillé 3 mois en intérim puis 3 mois en CDD peut ouvrir des droits, car il atteint la durée minimale de 6 mois.
De même, un salarié qui travaille 2 mois comme serveur en été, puis un 1 mois comme employé administratif en automne et enfin 3 mois dans la logistique en hiver, peut cumuler ces périodes pour atteindre les 130 jours requis.
A contrario, après un CDD de 2 ou 3 mois ou après un CDD saisonnier, le salarié ne pourra pas bénéficier de l’allocation chômage si ces CDD ne sont pas complétés par d’autres contrats de travail au cours des 24 derniers mois.
Être inscrit comme demandeur d’emploi
Pour toucher le chômage après son CDD, le salarié doit s’inscrire à France Travail dans les 12 mois qui suivent la fin de son contrat.
Être à la recherche active d’un emploi
Pendant toute la durée de son inscription à France Travail, le salarié doit être à la recherche effective et permanente d’un emploi. Il peut également réaliser une formation financée par France Travail ou par son CPF.
Être apte à l’exercice d’un emploi
Le salarié doit être physiquement apte à exercer un emploi, être disponible immédiatement et ne doit pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Résider habituellement en France
Son lieu de résidence habituel doit se situer en France métropolitaine ou ultramarine (à l’exception de Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) ou sur la Principauté de Monaco.
Un salarié qui résiderait plus de 6 mois par an à l’étranger ne pourrait pas prétendre au chômage après un CDD ni même après un CDI.

Comment sont calculées les allocations chômage après un CDD ?
Suite à la convention d’assurance chômage, signée par une majorité des organisations représentatives de salariés et d’employeurs, et entrée en vigueur le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028, de nouvelles règles d’indemnisation du chômage s’appliquent.
Certaines de ces nouvelles règles n’ont été mises en place qu’à partir du 1er avril 2025. Ces mesures concernent, pour la plupart, les demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient depuis le 1er avril 2025.
Le salaire journalier de référence (SJR)
Le Salaire Journalier de Référence sert de base de calcul aux allocations chômage. Il comprend toutes les sommes entrant dans la rémunération brute, soit :
- Le salaire de base.
- Les avantages en nature.
- Les primes.
- Les diverses indemnités (13è mois ; précarité de 10% ; compensatrice de congés payés…).
Le SJR est obtenu en divisant l’ensemble des rémunérations perçues (salaire de référence) par le nombre de jours compris entre le 1er et le dernier jour de travail sur la période de référence, selon l’âge du salarié : 24 mois s’il a moins de 55 ans et 36 mois s’il a 55 ans ou plus.
Depuis le 1er avril 2025, le paiement de l’allocation chômage est mensualisé sur une base de 30 jours calendaires quel que soit le mois ; le montant de l’allocation ne varie donc plus en fonction du nombre de jours dans le mois.
Le montant de l’allocation
Deux méthodes sont utilisées pour calculer le montant de l’ARE. Le montant le plus avantageux pour le salarié est retenu.
- 40,4 % x SJR + 13,18 €
ou
- 57 % x SJR
Le montant de l’indemnité ne doit pas être inférieur à 32,13 € (sauf en cas de travail partiel) et ne peut pas dépasser 75 % du SJR.
Depuis le 1er avril , la dégressivité de l’allocation chômage, qui concerne les demandeurs d’emploi percevant une indemnité journalière de plus de 92,12€, n’est plus appliquée aux allocataires ayant au moins 55 ans.
Faites le point sur vos pratiques RH en 3 minutes !
Vous vous demandez si vos pratiques RH sont vraiment efficaces ? Grâce à notre mini-diagnostic, obtenez un aperçu clair, rapide et gratuit de votre maturité RH. Vous découvrirez : vos forces RH actuelles, vos axes d’amélioration prioritaires et comment vous vous situez face aux autres PME. Ce diagnostic vous est proposé par notre partenaire Eurécia.
Je lance mon diagnosticLa durée d’indemnisation
Depuis le 1er avril 2025, les durées d’indemnisation maximales ne peuvent pas dépasser :
- 18 mois, soit 548 jours calendaires pour les moins de 55 ans.
- 22,5 mois, soit 685 jours calendaires pour les personnes de 55 ou 56 ans à la fin du CDD.
- 27 mois, soit 822 jours calendaires pour les salariés âgés d’au moins 57 ans à la fin de leur CDD.
Depuis le 1er avril 2025, par exception au droit commun, la durée minimale d’indemnisation pour les travailleurs saisonniers est fixée à 5 mois.
A lire également :
- Clause d’exclusivité dans le contrat de travail : définition et exemple
- Fermeture exceptionnelle imposée par l’employeur, que dit la loi ?
- Logiciel Recrutement: les 19 Meilleurs Outils ATS