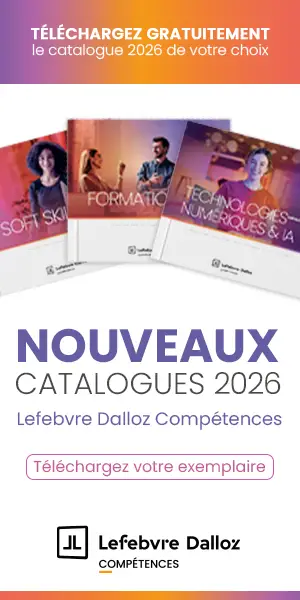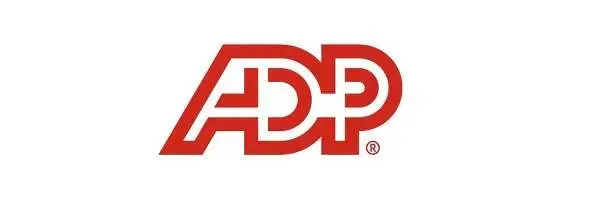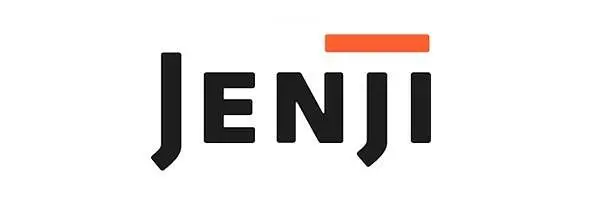Le mois de septembre 2025 a été marqué par plusieurs mouvements sociaux, visant notamment à dénoncer certaines mesures du budget 2026.
Ces mobilisations sont largement soutenues par les organisations syndicales qui appellent à la manifestation, entraînant de fortes perturbations, en particulier dans les transports.
Dans ce contexte, il est important de rappeler les règles relatives au droit de grève, afin que les professionnels des Ressources Humaines puissent gérer efficacement cette rentrée perturbée par l’actualité sociale.
Comprendre les droits et les obligations de l’employeur permet d’anticiper les situations difficiles et de préserver la continuité de l’activité tout en respectant la législation.
A lire également :
- Note de service : utilité, contenu, exemples et modèle, tout savoir !
- Délégation de pouvoir : définition et conditions de validité
- Comment rédiger une clause de mobilité ?
Le cadre légal de la grève
En France, le droit de grève est un droit constitutionnel, prévu par le Préambule de la Constitution de 1946 qui a valeur constitutionnelle. Il constitue un principe fondamental, garantissant aux salariés la possibilité de défendre leurs intérêts professionnels.
Tout salarié peut exercer ce droit, qu’il soit syndiqué ou non, sous réserve de respecter certaines règles.
En effet, pour être considérée comme licite, la grève doit réunir ces conditions :
- Un arrêt total du travail : le salarié cesse toute activité professionnelle pendant la durée du mouvement. Il ne suffit pas de ralentir son travail ou de se limiter à un simple retard dans l’exécution de ses tâches.
- Un arrêt collectif du travail : en cas de grève interne à l’entreprise, le mouvement doit être suivi par au moins deux salariés, sauf si l’entreprise n’emploie qu’un seul salarié. En revanche, le salarié peut accompagner un appel à la grève lancé au niveau national, comme cela est le cas des mouvements du 10 et 18 septembre 2025.
- Des revendications professionnelles : les motifs de la grève doivent être liés aux conditions de travail, à la rémunération ou à d’autres sujets professionnels, ce qui exclut les motifs purement politiques. Ces revendications doivent être portées à la connaissance de l’employeur au plus tard au moment de l’arrêt de travail ; il n’existe aucun formalisme particulier.
Dans le secteur privé, la grève ne nécessite pas de préavis, sauf dans certains cas particuliers.
En effet, au sein d’une entreprise privée chargée d’un service public (dans le secteur des transports par exemple) des règles particulières s’appliquent afin de garantir un service minimum aux usagers.
Les droits et obligations de l’employeur
La suspension du contrat et de la rémunération
Pendant la grève, le contrat de travail du salarié gréviste est suspendu, tout comme sa rémunération : l’employeur peut effectuer une retenue sur salaire, mais elle doit être strictement proportionnelle à la durée de l’absence.
Il est important de souligner que le salarié qui informe son employeur de sa participation ne peut être considéré comme étant en absence injustifiée.
Exemple : si un salarié participe à une grève durant deux heures sur une journée de sept heures, la retenue sur salaire ne peut porter que sur ces deux heures.
À noter que la grève n’est pas soumise à une durée légale minimale ou maximale ; elle peut être de courte durée (une heure, deux heures) ou bien se prolonger dans le temps.
La protection contre toute sanction disciplinaire
Un salarié ne peut pas être sanctionné pour avoir exercé son droit de grève. Toutefois, certains comportements peuvent constituer un abus :
- Dégradations du matériel ou des locaux de l’entreprise.
- Séquestrations ou violences à l’encontre de collègues ou de la direction.
- Entrave à la production ou au fonctionnement normal de l’entreprise de manière délibérée.
Dans ces situations, la grève est jugée illicite et l’employeur peut engager des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde, qui se caractérise par une intention de nuire à l’entreprise.
Exemple : un salarié qui bloque l’accès à un site de production et endommage des machines commet une faute lourde. Dans ce cas, la protection liée à l’exercice du droit de grève ne s’applique pas.
Le maintien de l’activité de l’entreprise
Pour l’employeur, la priorité est d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et de limiter les impacts sur la production et la clientèle. Cela peut se traduire par :
- Une réorganisation temporaire des équipes.
- Le report de certaines tâches.
En revanche, l’employeur ne peut pas réquisitionner un salarié gréviste, ni le remplacer par un salarié en contrat à durée déterminée ou un intérimaire pour la durée de la grève.
Toute tentative de contourner ce principe peut être considérée comme une violation du droit de grève et exposer l’entreprise à des risques juridiques.
En pratique : conseils pour les professionnels RH
Que la grève soit interne à l’entreprise ou qu’il s’agisse d’un mouvement social national, il est l’occasion pour l’employeur de maintenir un dialogue social en communiquant avec les salariés et/ou avec les représentants du personnel s’il y en a.
Concernant les prochains mouvements sociaux nationaux, il est conseillé d’anticiper les impacts de la grève sur l’organisation :
En mettant en place des mesures temporaires
Les potentielles perturbations dans les transports peuvent entraîner des retards ou des absences de la part des salariés. Afin de réduire les effets de ces imprévus, plusieurs solutions peuvent être envisagées :
- Le recours au télétravail pour les postes compatibles.
- Le report ou la priorisation de certaines tâches non urgentes.
- L’adaptation des horaires de travail.
L’objectif est de donner de la souplesse à l’organisation tout en maintenant un niveau minimal d’efficacité.
En élaborant un plan de continuité de l’activité
Cela suppose de :
- Distinguer les activités essentielles de celles pouvant être mises en pause temporairement.
- Cartographier les compétences clés, notamment les salariés capables d’occuper plusieurs postes ou de prendre en charge des missions transversales.
Pour aller plus loin, il est également possible de définir différents scénarios en fonction du taux de participation à la grève, avec des solutions adaptées pour chacun.
Cette préparation permet d’éviter les décisions improvisées et de sécuriser l’activité face à un contexte incertain.
En préparant sa communication interne et externe
La communication joue un rôle central dans la gestion de la grève ; elle doit être à la fois factuelle et rassurante.
L’enjeu est de maintenir le lien, de renforcer la transparence et de préserver la confiance. Il convient au préalable d’identifier ses cibles (salariés, clients…) et de choisir les canaux de communication les plus adaptés.
- En interne : informer les salariés sur le cadre légal, le déroulement de la grève, le taux de participation ainsi que sur les mesures organisationnelles prévues (réaffectations, ralentissement de certaines activités, priorités fixées…).
- En externe : prévenir les clients des éventuels impacts et présenter les solutions mises en place pour limiter les désagréments.
En formant et accompagnant les managers de proximité
En première ligne face aux équipes, les managers jouent un rôle clé. Ils doivent être préparés à gérer les tensions éventuelles, à éviter toute pression sur les grévistes et à maintenir une égalité de traitement entre grévistes et non-grévistes.
Ils peuvent bénéficier de formations à la fois sur les techniques de communication et de gestion des conflits, mais aussi sur les aspects juridiques liés à la grève.
La gestion des compétences : un enjeu stratégique pour préparer l'avenir
En 45 minutes, découvrez comment faire de la gestion des compétences un outil de pilotage RH à part entière. Ce webinaire animé par deux experts RH de notre partenaire Eurécia vous donnera des conseils et exemples concrets ainsi que deux outils prêts à l’emploi pour piloter vos compétences au quotidien.
Je m’inscrisLes équipes RH ont, en parallèle, un rôle d’appui et de conseil pour les guider dans leur conduite à tenir, afin d’éviter tout faux pas dans un contexte souvent sensible.
En conclusion, la grève constitue un droit fondamental pour le salarié, mais elle entraîne également des obligations pour l’employeur.
Pour les professionnels RH, la gestion de la grève de manière efficace et opérationnelle suppose une connaissance des dispositions légales et conventionnelles, mais également la capacité à anticiper les impacts sur l’organisation.
Respecter le droit de grève tout en assurant la continuité de l’activité nécessite :
- Une connaissance des règles applicables.
- Le maintien d’un dialogue social constructif.
- Des mesures concrètes pour anticiper les perturbations.
En cas de doute, il est recommandé de solliciter l’avis d’un juriste ou d’un avocat spécialisé pour sécuriser les décisions et éviter tout risque juridique.
A lire également :
- Réserves sur un accident du travail : ce que dit la loi + exemples
- Grève perlée : définition, droit, licéité… tout savoir !
- Refus de rupture conventionnelle par l’employeur : quels motifs légitimes ? Comment les traiter ?