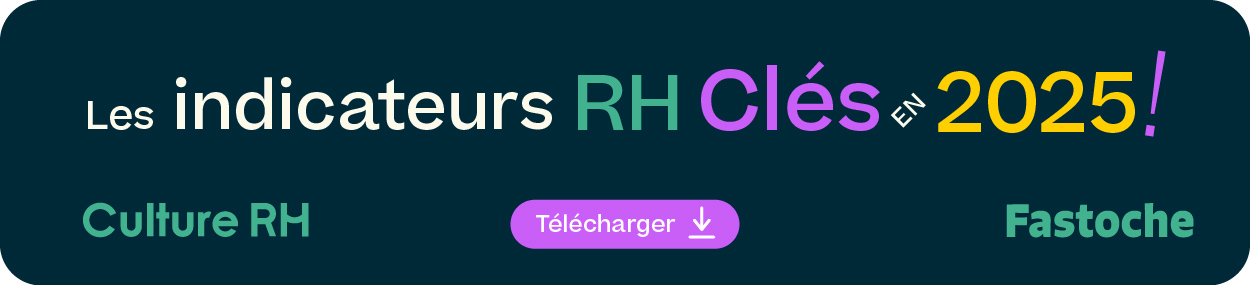Pour ce dernier mois de l’année 2022, la Cour de cassation a apporté quelques solutions inédites, prise de position inhabituelle ou revirement de jurisprudence, qui doivent retenir toute notre attention, notamment en matière de liberté d’expression du salarié ou concernant la définition de temps de travail effectif des salariés itinérants.
Contrat de travail
Cass.soc. 14 décembre n°21-19.841, FS-B
CDD : l’apposition d’une signature manuscrite numérisée ne vaut pas absence de signature justifiant la requalification en CDI.
Un salarié en CDD saisonnier prend acte de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite. Il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du CDD en CDI.
Pour le salarié, une signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale, ni une signature électronique et n’a aucune valeur juridique. En l’absence de signature régulière par l’une des parties, le CDD n’est pas considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La chambre sociale de la Cour de cassation, confirme l’arrêt d’appel, et décide que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut pas être assimilée à une signature électronique au sens du code civil.
Cependant, elle retient qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la signature en cause est celle du gérant de la société et permet parfaitement d’identifier son auteur, lequel est habilité à signer un contrat de travail.
Par conséquent, l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne vaut pas absence de signature, et la demande de requalification doit être rejetée.
Inaptitude professionnelle
Cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-23662 FSB ; cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-17927 FSB
En l’absence de recours en contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail devant le Conseil des prud’hommes dans un délai de 15 jours, cet avis s’impose à l’employeur, au salarié et au juge.
Un salarié est déclaré « inapte total » par le médecin du travail qui précise, dans l’avis, que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Le salarié licencié conteste son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, car il estime que son inaptitude n’a pas été constatée de manière régulière parce que le médecin du travail n’a pas réalisé d’étude de poste.
Cependant, le salarié n’a pas contesté l’avis d’inaptitude dans les délais alors que l’avis indiquait bien les délais et voies de recours.
La Cour de cassation décide qu’à défaut de contestation dans le délai de 15 jours, la régularité de l’avis d’inaptitude ne peut plus être contestée et l’avis s’impose à l’employeur, au salarié et aux juges.
Dans une seconde décision relative à l’inaptitude rendue le même jour et où l’étude de poste préalable manquait également, la Cour de cassation insiste sur le fait que le recours contre un avis d’inaptitude ne peut reposer que sur l’avis du médecin du travail en lui-même et non sur une irrégularité de procédure.
Ces deux affaires démontrent donc que le fait que le médecin du travail ne respecte pas la procédure n’affecte pas, à lui seul, la validité de l’avis d’inaptitude rendu.
Liberté d’expression du salarié
Cass.soc. 7 dec 2022, n°21-19280 FD
Un salarié qui multiplie les menaces commet un abus de droit justifiant son licenciement.
Dans cet arrêt, les juges ont retenu à la fois un abus de la liberté d’expression et un abus du droit d’agir en justice, solution assez rare pour être relevée.
Un conducteur de métro à la RATP est révoqué pour faute grave.
Il lui est reproché, d’une part, d’avoir tenté d’intimider son supérieur hiérarchique en le menaçant d’aller porter plainte contre lui du fait de sa convocation à un entretien disciplinaire.
Le salarié, voyant là une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice, considère que sa révocation est nulle et saisit les juges pour en demander l’annulation.
La cour d’appel donne tort au salarié et décide que ce dernier avait abusé de son droit d’agir en justice.
En effet, le salarié avait déjà été en justice pour contester des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, demander une reconstitution de carrière et la réparation du harcèlement moral dont il estimait être victime. Il n’avait pas obtenu gain de cause.
D’autre part, le salarié se voyait aussi reprocher une faute grave du fait de propos injurieux tenus à de nombreuses reprises.
Or, pour ce dernier, il n’y avait pas là d’abus de sa liberté d’expression caractérisant une faute grave.
Ici aussi, la cour d’appel donne tort au salarié et souligne que l’ensemble des propos tenus par le salarié caractérisait un abus de sa liberté d’expression. Pour elle, le fait d’avoir tenu de manière répétée des propos ironiques révélateurs de son insubordination face à sa hiérarchie, dans un contexte global de menaces envers ses collègues, était fautif.
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, réaffirme que le salarié qui réitère des propos ironiques révélant son insubordination face à son chef et veut l’intimider en le menaçant à plusieurs reprises de déposer plainte contre lui peut être licencié pour faute grave.
A lire également :
- Comment optimiser la gestion de ses paies ?
- Chômage partiel : comment le traiter en paie ?
- Comment traiter la paie d’un salarié payé au SMIC ?
Licenciement économique et obligation de reclassement préalable
Cass.soc. 7 dec 2022 n°21-16.000F-B
ROI Formation : enjeux, calcul et optimisation en 2025
Alors que les budgets se resserrent, 1 DRH sur 2 peine à démontrer l'efficacité des actions de formation. Pourtant, il existe des méthodes concrètes pour prouver leur retour sur investissement. Dans ce livre blanc, Culture RH décrypte les bons indicateurs à suivre, les pièges à éviter et les étapes clés pour calculer efficacement le ROI de vos actions de formation.
Je téléchargeL’employeur ne peut pas limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.
Une salariée se voit notifier la future suppression de son poste et l’absence de possibilité de reclassement. L’employeur lui propose un accompagnement à la recherche d’emploi.
La salariée refuse et informe son employeur de son souhait d’être licenciée rapidement afin de pouvoir accepter une offre d’embauche et d’occuper rapidement ce nouvel emploi.
La salariée saisit néanmoins la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.
La Cour d’appel condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que :
- La salariée a renoncé à l’exécution du préavis avant la notification de son licenciement, rendant sa renonciation non valable.
- Le fait que la salariée a indiqué bénéficier d’une embauche et demandé d’enclencher le licenciement, ne dispense pas l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement économique.
- L’employeur n’a pas proposé à la salariée les postes disponibles dans le plan de mobilité professionnelle et n’a donc pas satisfait sérieusement à ses obligations légales en matière de licenciement économique.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle qu’”est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement économique d’une salariée à qui l’employeur n’a pas proposé les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle après que l’intéressée lui a indiqué qu’elle bénéficiait d’une embauche et lui a demandé d’enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvant pas dispenser l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économiques.”
Autrement dit,
– Un employeur doit effectuer des recherches de reclassement dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, sans tenir compte du souhait exprimé par la salariée de quitter rapidement son poste.
– L’employeur et le salarié ne peuvent pas renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.
Temps de travail effectif
Cass.soc. 23 novembre 2022, n°20-21.924
Le temps de trajet domicile-premier client et dernier client-domicile, d’un salarié itinérant peut être du temps de travail effectif.
À noter : Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence et doit donc retenir l’attention.
Un salarié itinérant sollicite la résiliation judiciaire de son contrat et réclame à cette occasion le paiement d’heures supplémentaires liées à ses temps de trajet. Les juges du fond le lui accordent.
L’entreprise conteste cette décision et s’appuie, à cette fin, sur l’article L3121-4 du Code du travail selon lequel “le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.”
Dans cet arrêt, la Cour de cassation modifie sa position antérieure et retient que les articles L.3121-1 et L.3121-4 du Code du travail doivent être interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE. Ainsi, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ils ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du Code du travail.
En effet, la Cour de cassation revient sur sa position classique en considérant que « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif », il convient d’en tenir compte pour déterminer les règles relatives au temps de travail (heures supplémentaires, droit au repos, etc.).
Ainsi, pour la Cour de cassation, l’appréciation des temps de trajets doit se faire, désormais, en deux étapes :
Temps 1 : le temps de trajet répond-il à la définition du temps de travail effectif ? Le salarié est-il à la disposition de l’employeur et se conforme-t-il à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ?
Temps 2 : s’il est répondu négativement à la question ci-dessus, le temps de trajet est-il « normal » ?
Dans cette affaire, le salarié « devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs.
La Cour de cassation en conclut donc que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premiers et dernier client, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Ces temps doivent donc être intégrés dans le temps de travail et rémunérés comme tel. C’est pourquoi, la Cour de cassation confirme logiquement le rappel d’heures supplémentaires.
A lire également :
- La cooptation, c’est quoi ? Comment l’encourager dans votre entreprise ?
- Test de personnalité en recrutement : à quoi sert-il ? Comment l’utiliser ?
- Le livret d’accueil : Pourquoi et comment le mettre en place ?