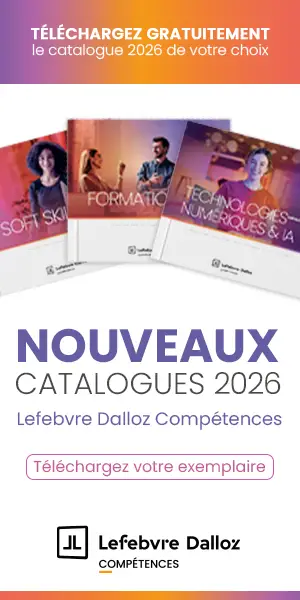Transparence salariale : des entreprises françaises à la traîne
À quelques mois de l’entrée en vigueur de la directive européenne sur la transparence salariale, prévue pour juin 2026, les entreprises françaises apparaissent encore à la traîne.
Selon une étude SD Worx de septembre 2025, près de 50 % des employeurs affirment travailler activement sur ce sujet, mais l’autre moitié reste en retard.
Ce manque d’anticipation s’explique aussi par un déficit d’information : seuls 16 % des Français connaissent précisément cette directive et 37 % n’en ont jamais entendu parler.
Du côté des salariés, les attentes sont fortes. Une enquête menée par Indeed et PageGroup en avril 2025 montre que 44 % des salariés français pensent être moins bien rémunérés que la moyenne pour un poste équivalent.
Cette perception alimente un climat d’insécurité, notamment chez les jeunes, dont 61 % seraient prêts à demander le salaire de leurs collègues, tout en étant 65 % à craindre de découvrir un écart défavorable. Le tabou sur le sujet reste donc puissant et freine les discussions salariales en entreprise.
Les recruteurs eux-mêmes se trouvent face à des contradictions. Toujours selon l’étude Indeed-PageGroup, 89 % estiment que la transparence salariale constitue un avantage dès le recrutement, mais près d’un tiers n’affichent jamais le salaire dans leurs annonces.
Une enquête How Much révèle aussi que 63 % des salariés ignorent totalement le salaire de leurs collègues et 62 % ne connaissent pas les critères d’augmentation dans leur entreprise. Cette opacité entretient frustrations et méfiance.
La directive de 2026 changera radicalement la donne. Les entreprises de plus de 100 salariés devront publier leurs écarts de rémunération et justifier ceux dépassant 5 %. Les salariés pourront comparer leur rémunération à celle de collègues équivalents, obligeant les employeurs à clarifier leurs critères.
Cette réforme impose un tournant culturel : passer d’une logique de discrétion à une politique proactive, garante d’équité et de confiance au sein des équipes.
Cotisations sociales et patronales : ce qui a changé en 2025
En 2025, les cotisations sociales évoluent nettement pour les employeurs. La réforme des allègements s’amorce avant un grand basculement en 2026. Les RH doivent ajuster leurs paramétrages dès à présent.
La réduction générale change de cap. Le SMIC de référence est fixé à 11,88 € pour l’année. La PPV entre dans l’assiette et la formule du coefficient.
Autre pivot majeur au 1er mai 2025 : le paramètre T diminue légèrement. Il intègre la hausse de la fraction AT/MP et la baisse de la cotisation chômage. Résultat : de nouvelles valeurs T selon la taille et le FNAL.
La cotisation patronale chômage passe de 4,05 % à 4 %. Le bonus-malus est recalculé en conséquence. Les taux AT/MP 2025 s’appliquent aussi à compter du 1er mai.
Les taux réduits maladie et allocations familiales deviennent plus restrictifs. Les plafonds d’éligibilité sont abaissés pour 2025. Une tolérance est admise pour certains sortants de début d’année.
Les exonérations spécifiques restent protégées. Elles ne subissent pas la réforme des allègements généraux. La PPV n’est pas intégrée dans leurs calculs.
Côté apprentis, le régime social est durci pour les nouveaux contrats. L’exonération salariale est limitée à 50 % du SMIC dès le 1er mars. La fraction excédentaire est désormais soumise à CSG/CRDS.
Le BOSS précise deux méthodes pour gérer 2025. Un calcul différencié avant et après le 1er mai est possible. Une moyenne pondérée des deux T est tolérée pour l’année.
L’IA au service de la Paie en 2025 ?
En 2025, l’intelligence artificielle s’impose comme un allié stratégique dans la gestion de la paie. Longtemps cantonnée à l’automatisation de tâches simples, elle devient désormais un levier d’efficacité pour les services RH confrontés à des environnements de plus en plus complexes.
Télétravail, contrats courts, horaires flexibles : ces nouvelles configurations multiplient les cas particuliers et rendent la paie plus difficile à gérer manuellement.
Selon une étude PayFit et YouGov, seules 34 % des PME françaises utilisent un logiciel de paie, alors que 76 % des décideurs reconnaissent leur utilité pour traiter des situations complexes. L’IA va plus loin : elle ne se limite pas à automatiser la saisie des données.
Elle détecte les anomalies, alerte sur les erreurs potentielles et optimise le contrôle en amont de la clôture. Les gestionnaires de paie peuvent ainsi consacrer davantage de temps à des missions stratégiques, comme la conformité ou le conseil RH.
Parmi les applications concrètes, l’IA prend en charge l’extraction automatique des informations des notes de frais, la gestion des arrêts maladie, l’analyse des absences ou encore le calcul des droits sociaux.
Elle permet aussi de simuler différents scénarios de rémunération et d’identifier des leviers d’optimisation, réduisant les coûts tout en sécurisant les process.
Si certains imaginent une automatisation totale de la paie d’ici 2050, les experts rappellent qu’une supervision humaine restera indispensable.
Les zones grises,décisions sensibles, cas litigieux, négociation collective, nécessitent toujours l’expertise d’un gestionnaire. L’IA et la paie ne sont donc pas en opposition : elles se complètent.
Bien exploitée, l’IA ouvre la voie à une paie plus fiable, plus rapide et plus souple, au service des entreprises comme des salariés.
Indemnisation arrêt maladie : des changements majeurs depuis le 1er avril 2025
Depuis le 1er avril 2025, l’indemnisation des arrêts maladie a connu une évolution majeure qui impacte directement les salariés comme les employeurs.
Le plafond des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie a été abaissé, passant de 1,8 à 1,4 fois le Smic. Concrètement, le montant maximal brut versé par jour chute de 53,31 à 41,47 euros.
L’indemnité reste calculée sur 50 % du salaire journalier de base, établi selon les trois derniers mois de rémunération (ou douze pour les revenus variables).
Pour les salariés rémunérés en dessous de 1,4 Smic, cette réforme ne change rien. En revanche, pour ceux dont le salaire dépasse 2 522,57 euros, la perte est réelle : un salarié payé 1,8 Smic peut perdre jusqu’à 355 euros sur un mois complet d’arrêt.
Cette mesure, qui ne concerne pas les arrêts liés aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, s’inscrit dans une logique d’économie publique.
Le gouvernement espère ainsi réduire les dépenses de Sécurité sociale de 400 à 600 millions d’euros par an. Mais elle transfère une partie de la charge financière vers les entreprises, tenues d’assurer un maintien de salaire à 90 % après sept jours de carence pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.
Les régimes de prévoyance deviennent donc centraux. Déjà largement présents, ils compenseront en partie la baisse, mais leur coût devrait augmenter, avec des cotisations en hausse estimée à 2 %.
La gestion des compétences : un enjeu stratégique pour préparer l'avenir
En 45 minutes, découvrez comment faire de la gestion des compétences un outil de pilotage RH à part entière. Ce webinaire animé par deux experts RH de notre partenaire Eurécia vous donnera des conseils et exemples concrets ainsi que deux outils prêts à l’emploi pour piloter vos compétences au quotidien.
Je m’inscrisPour les salariés sans couverture complémentaire, intérimaires, saisonniers, contrats courts, l’impact est immédiat et intégral.
Cette réforme marque un tournant dans la protection sociale : elle renforce le rôle des couvertures privées et incite à une réflexion plus large sur la prévention et la gestion des arrêts de travail.
Pour les RH, il devient essentiel d’anticiper ces évolutions et d’adapter leurs dispositifs de prévoyance pour préserver l’équilibre entre coût et attractivité sociale.
Congés payés : les nouvelles règles
Depuis avril 2024, de nouvelles règles s’appliquent aux congés payés, alignant le Code du travail sur le droit européen.
Désormais, un salarié en arrêt maladie, qu’il soit d’origine professionnelle ou non, continue d’acquérir des droits à congés. Cette réforme s’applique pleinement en 2025 et impose de nouvelles obligations aux employeurs.
Un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle cumule deux jours ouvrables de congés par mois, dans la limite de 24 jours pour une période complète.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le calcul passe à 2,5 jours par mois, soit un maximum de 30 jours. Les conventions collectives peuvent toutefois prévoir des règles plus favorables.
Autre nouveauté, l’employeur doit informer le salarié, dans le mois suivant sa reprise, du nombre de jours acquis et de leur date limite d’utilisation.
Cette communication doit être formalisée pour constituer une preuve en cas de litige. Par ailleurs, une période de report de 15 mois s’applique si le salarié n’a pas pu prendre ses congés dans le délai normal.
Enfin, la loi a un effet rétroactif jusqu’en décembre 2009, avec un plafond de 24 jours pour les périodes couvertes.
Cette rétroactivité, combinée aux nouvelles modalités de calcul de l’indemnité, complexifie la gestion pour les services RH et paie. Un suivi précis s’impose donc pour garantir la conformité.
La prime “Macron” est morte, vive la prime PPV !
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, plus connue sous le nom de prime « Macron », appartient désormais au passé.
Depuis 2025, elle est remplacée par la prime de partage de la valeur (PPV), conçue comme un dispositif pérenne de redistribution au sein des entreprises. L’objectif reste le même : associer les salariés aux résultats, améliorer leur pouvoir d’achat et renforcer la cohésion interne.
La prime PPV n’est pas obligatoire pour toutes les entreprises. Elle peut être versée sur décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE, ou par accord collectif.
La loi permet même de verser deux primes par an, chacune disposant de ses propres conditions et modalités. Ce caractère modulable offre aux dirigeants une certaine souplesse dans l’attribution et le calendrier de versement.
En pratique, la PPV bénéficie d’un régime social et fiscal avantageux. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans certaines limites, ce qui en fait un outil attractif pour les employeurs comme pour les salariés.
Elle ne peut cependant pas se substituer à un élément de rémunération existant, ni remplacer une prime conventionnelle. Elle doit rester un véritable complément.
Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés ayant dégagé un bénéfice net suffisant sur trois exercices consécutifs sont tenues de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. La prime PPV constitue alors l’une des options possibles.
Pour les TPE et PME, elle devient donc un levier concret pour fidéliser les équipes et valoriser l’engagement collectif, tout en s’inscrivant dans une logique durable de reconnaissance au travail.
Frais de transport domicile / travail : la mise à jour du BOSS en 2025
En 2025, le BOSS a intégré les nouveautés prévues par la loi de finances concernant la prise en charge des frais domicile-travail.
Les employeurs doivent continuer à rembourser au minimum 50 % des abonnements de transport public ou de location de vélos. Cette obligation s’applique à tous les salariés, y compris à temps partiel, et reste exonérée d’impôt et de cotisations sociales.
La nouveauté réside dans la prolongation de la prise en charge renforcée. Les entreprises peuvent désormais couvrir jusqu’à 75 % du coût des abonnements, toujours en bénéficiant d’une exonération sociale et fiscale.
Cette option offre un réel levier pour soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs tout en optimisant les charges de l’entreprise. Le remboursement doit être effectué chaque mois, sur présentation du titre de transport.
Au-delà des transports publics, d’autres dispositifs demeurent accessibles. La prime de transport reste exonérée jusqu’à 600 euros par an, dont 300 pour le carburant.
Le forfait mobilités durables, cumulable avec la prise en charge obligatoire, est exonéré jusqu’à 900 euros par an. Ces mesures encouragent les mobilités douces et renforcent la politique sociale et environnementale des employeurs.