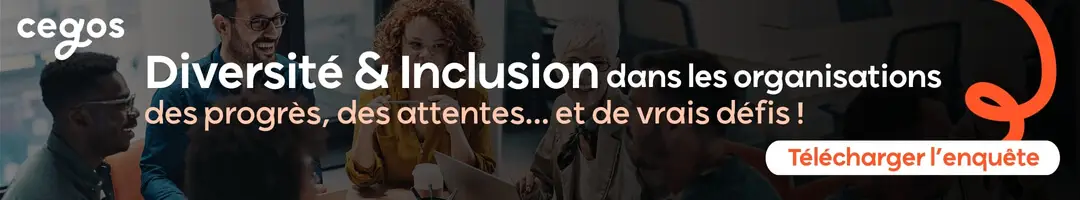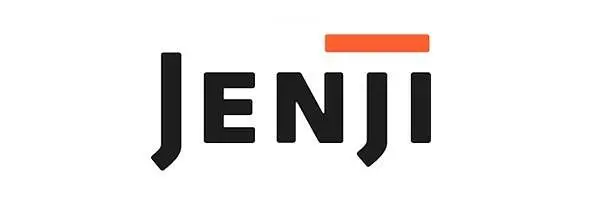Travailler le 1er mai : vers une clarification juridique attendue
Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé pour tous les salariés en France. C’est ce que garantit l’article L.3133-4 du Code du travail.
Une exception existe toutefois pour les secteurs où l’activité ne peut être interrompue, comme les hôpitaux ou les transports.
Mais depuis plusieurs années, des professionnels comme les boulangers, fleuristes ou restaurateurs poursuivent leur activité ce jour-là. En avril 2024, certains d’entre eux ont pourtant été verbalisés pour avoir fait travailler leurs salariés.
Épargne salariale 2025 : l’essentiel dans ce guide !
Le partage de la valeur est un excellent moyen d’associer les salariés à la réussite de l’entreprise, encore faut-il l’utiliser correctement ! Différents types d’épargne, avantages, inconvénients, modalités de mise en place…. Toutes les réponses dans notre guide pratique 2025 ! Ce guide vous est proposé par notre partenaire Lamy Liaisons.
Je téléchargeCela a mis en lumière un flou juridique difficile à ignorer. Car si ces professionnels sont souvent tolérés, aucune base légale claire ne permet d’encadrer leur situation.
Pour combler cette faille, le Sénat a adopté, le 3 juillet 2025, une proposition de loi centriste. L’objectif ? Offrir une base légale solide à certains secteurs pour travailler le 1er mai. Le texte vise aussi à sécuriser les employeurs tout en encadrant strictement les droits des salariés.
A lire également :
- Journée de solidarité : qu’est-ce que c’est ? Comment la traiter en paie ?
- Jour de Fractionnement : règles, conditions et calcul
- Rachat des jours de RTT en 2025 : bénéficiaires, conditions, procédure, traitement paie… Tout savoir !
Qui pourra travailler le 1er mai, et dans quelles conditions ?
Le texte voté prévoit une dérogation légale pour certains établissements. Il s’agit des commerces de bouche de proximité (boulangeries, boucheries, pâtisseries), des fleuristes, des jardineries ainsi que des cinémas et théâtres.
Les grandes surfaces, elles, sont explicitement exclues de cette dérogation.
Ce travail ne pourra pas être imposé. Il devra reposer sur le volontariat du salarié et faire l’objet d’un accord écrit entre les deux parties. Le salarié devra donc exprimer un consentement libre et éclairé. En cas de refus, l’entreprise ne pourra appliquer aucune sanction, ni engager de procédure disciplinaire ou de licenciement.
Autre point important : les salariés concernés seront rémunérés double, comme le prévoit la règle pour les jours fériés travaillés. Cette mesure vise à reconnaître la spécificité du 1er mai, fête des travailleurs, tout en assurant une compensation juste.
Une adoption contestée, mais soutenue par le gouvernement
Le texte a provoqué de vifs débats au Sénat, notamment entre la droite et la gauche. Le groupe communiste a dénoncé une “régression sociale” et une atteinte symbolique à la fête des travailleurs.
Les syndicats, unanimes, s’y opposent. Ils estiment que le volontariat ne peut être garanti dans une relation salariale marquée par un lien de subordination.
Du côté du gouvernement et de la majorité sénatoriale, on défend une mesure de bon sens. Il s’agirait simplement de légaliser une pratique existante, tout en sécurisant les deux parties. Pour la ministre du Travail, cette loi comblera “une faille juridique” sans remettre en cause le caractère férié du 1er mai.
Le texte doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale. Il pourrait encore évoluer, mais son objectif principal reste clair : encadrer juridiquement une réalité économique, sans affaiblir les droits des salariés.
Pour les RH, il conviendra de suivre de près l’évolution du texte et d’anticiper, le cas échéant, la mise en œuvre concrète de ces nouvelles règles en 2026.
A lire également :
- Journée de solidarité : Quel rôle pour le CSE ?
- Forfait jours : comment calculer les jours de repos (RTT) ?
- Fermeture exceptionnelle imposée par l’employeur, que dit la loi ?