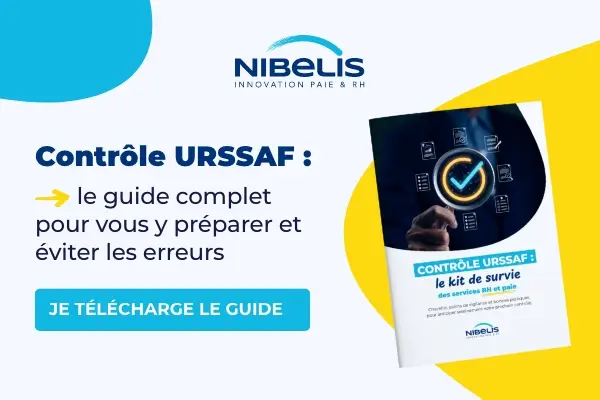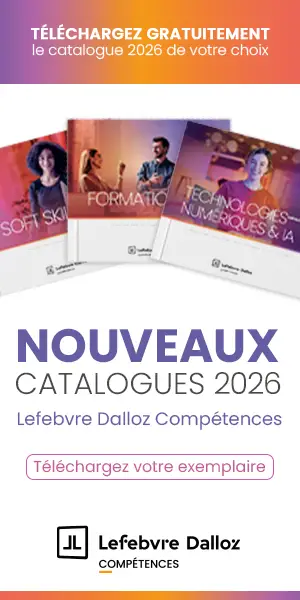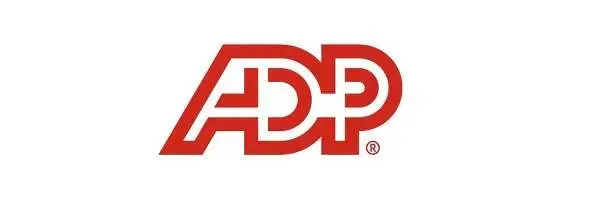CPF, Apprentissage, contrat de professionnalisation : ce qui a changé en 2025
En 2025, les dispositifs de formation et d’alternance connaissent des modifications significatives. Pour les services RH, il est essentiel de maîtriser ces changements afin d’orienter les salariés, ajuster les stratégies internes et optimiser les financements.
CPF : restrictions, abondements et participation obligatoire
Le CPF reste un pilier de la formation en entreprise, mais son usage est désormais plus encadré. Depuis 2025, toute activation des droits implique une participation financière obligatoire du salarié. Ce reste à charge prend la forme d’un forfait fixe, quel que soit le montant de la formation.
Indexée sur l’inflation, cette participation forfaitaire obligatoire a été revalorisée au 1er janvier 2025. Son montant est fixé à 102,23 €
Certaines catégories comme les demandeurs d’emploi peuvent en être dispensées, mais la logique générale est celle d’une responsabilisation accrue des bénéficiaires.
Le Ministère du Travail a rappelé également cette année que les formations liées à la création ou reprise d’entreprise ne sont plus éligibles, sauf si elles conduisent à un titre ou certificat reconnu. Ce recentrage exclut les parcours trop généralistes ou considérés comme insuffisamment professionnalisants.
En parallèle, les abondements employeurs sont facilités grâce à un portail dédié, permettant aux RH de participer au financement des formations stratégiques sans prendre en charge la totalité du coût. Le CPF devient donc un outil de co-construction plutôt qu’un droit individuel illimité.
Apprentissage : obligation employeur et proratisation
L’apprentissage conserve sa place centrale dans les politiques d’emploi, mais les financements évoluent.
Depuis juillet 2025, les entreprises recrutant un apprenti préparant un diplôme de niveau Bac+3 ou plus doivent verser une participation financière forfaitaire de 750€. Ce changement vise à impliquer davantage les employeurs dans la prise en charge réelle des parcours.
Autre évolution importante : les financements sont désormais proratisés au jour près en fonction de la durée effective du contrat. Jusqu’ici, les versements étaient souvent alignés sur des durées théoriques, quels que soient les aménagements du calendrier.
Enfin, les formations réalisées majoritairement à distance ont vu leur financement réduit, afin de favoriser la présence en centre et l’accompagnement pédagogique.
Ces mesures renforcent la logique de qualité et de conformité, mais imposent aux entreprises un suivi administratif plus rigoureux.
Contrat de professionnalisation : vers un nouveau paysage d’aides
Le contrat de professionnalisation fait l’objet d’un repositionnement plus discret, mais structurant. Les aides exceptionnelles versées lors des années précédentes ne sont pas reconduites en 2025, ce qui limite les incitations financières directes à l’embauche.
Les entreprises doivent désormais s’appuyer principalement sur les prises en charge fixées par les branches, sans soutien supplémentaire automatique. Le salaire minimal de l’alternant reste indexé sur l’âge et le niveau de qualification, sans changement majeur.
Toutefois, l’absence d’aide uniforme oblige les RH à comparer de manière plus fine les dispositifs disponibles. Pour certains profils, l’apprentissage devient plus avantageux ; pour d’autres, le contrat de professionnalisation garde son intérêt, notamment pour les adultes en reconversion.
Gestion des compétences : votre plan d'action RH pour 2026
En 45 minutes, découvrez comment faire de la gestion des compétences un outil de pilotage RH à part entière. Ce webinaire animé par deux experts RH de notre partenaire Eurécia vous donnera des conseils et exemples concrets ainsi que deux outils prêts à l’emploi pour piloter vos compétences au quotidien.
Je m’inscrisLe paysage des aides se simplifie donc, mais il devient plus sélectif. Les entreprises doivent désormais choisir en fonction de la rentabilité pédagogique plutôt que de l’attractivité financière.
La formation à l’IA, plus qu’un besoin, une obligation
L’intelligence artificielle s’est invitée dans les entreprises sans attendre leur feu vert. Selon une étude SAP/Odoxa, 51 % d’entre eux considèrent déjà l’IA comme un outil capable d’améliorer le recrutement.
Mieux encore, six salariés sur dix souhaiteraient que leur entreprise accélère son intégration dans les pratiques quotidiennes.
Le message est clair : l’IA est désirée. Mais son utilisation et son apprentissage sont encore mal encadrés. Car seuls 28 % des employés affirment avoir été formés à son usage. La majorité teste des outils en autonomie, souvent sans validation de la hiérarchie. Les collaborateurs avancent, les organisations suivent.
Résultat : des gains de productivité, mais aussi des risques juridiques et éthiques. Entre improvisation et opportunités, la frontière devient trop fine pour rester sans cadre.
Former à l’IA n’est donc plus un choix stratégique, c’est un impératif opérationnel. Sans lignes directrices, chaque salarié développe ses propres méthodes et les erreurs peuvent se multiplier.
L’IA change les métiers : la formation devient un filet de sécurité
L’étude APEC de juin 2025 montre que 35 % des cadres et 42 % des managers utilisent déjà l’IA au moins une fois par semaine. Parmi les usages les plus fréquents : la synthèse de documents, la gestion de données et la rédaction de supports internes. Ce ne sont plus des “tests”, mais de véritables habitudes de travail.
Face à cette accélération, la question n’est plus “Faut-il former ?”, mais “Peut-on se permettre de ne pas le faire ?”.
Car un salarié non formé peut certes gagner du temps, mais sans toujours comprendre comment vérifier la fiabilité d’un contenu généré. À l’inverse, un salarié formé devient plus autonome, plus rapide et surtout plus conscient des limites de l’outil.
Former, c’est aussi protéger l’entreprise. Avec l’arrivée de la régulation européenne AI Act, les organisations devront bientôt prouver qu’elles maîtrisent l’usage de l’IA en interne.
Or sans montée en compétences, impossible de respecter ces exigences. Le risque ne se mesure plus seulement en productivité, mais en conformité.
La formation à l’IA n’est donc plus un programme supplémentaire, c’est le socle des pratiques professionnelles à venir. Dans les mois qui viennent, les entreprises devront choisir entre subir l’IA ou la maîtriser.
Montée en compétences et formation en interne : une demande croissante
La demande de formation interne n’a jamais été aussi forte. Les collaborateurs ne se contentent plus de suivre un plan de développement figé une fois tous les deux ans ; ils veulent évoluer en continu, au rythme des transformations technologiques et organisationnelles.
La montée en compétences n’est plus une option mais une attente clairement exprimée
Selon une étude de l’IFOP pour la Fondation The Adecco Group / ANDRH, 84 % des actifs considèrent que la reconversion est une étape normale dans un parcours professionnel. Une part croissante des salariés exprime le souhait de changer de métier ou de domaine, sans pour autant quitter leur entreprise.
Ce besoin ne relève plus seulement de la fidélisation, mais d’une logique d’adaptation durable : un collaborateur qui ne progresse plus se désengage rapidement.
À l’inverse, celui qui perçoit des perspectives de progression, même latérales, reste mobilisé. La formation interne devient ainsi un levier de performance autant qu’un outil de rétention, car elle transforme les aspirations individuelles en moteur collectif.
L’autre évolution notable concerne le format attendu. Les salariés ne recherchent pas uniquement des formations longues et diplômantes ; ils veulent des parcours souples, applicables immédiatement à leurs missions, et intégrés dans le quotidien de travail.
Ce n’est plus la formation qui précède l’action, mais l’action qui sert de terrain de formation. L’essor des dispositifs comme l’AFEST (l’Action de formation en situation de travail ), le mentorat en binôme ou les immersions temporaires dans un autre service en témoigne : apprendre “par la pratique” est devenu la norme souhaitée.
Dans certains cas, la reconversion interne est même perçue comme une solution à la démotivation. Un collaborateur en perte de sens n’est pas forcément en échec ; il est parfois simplement mal positionné. Lui offrir la possibilité d’évoluer vers un autre poste, avec un accompagnement structuré, revient à transformer une fragilité en opportunité.
Former en interne, c’est anticiper les transformations avant d’avoir à les subir
Les directions qui intègrent la montée en compétences dans leur stratégie RH ne le font plus seulement par souci social, mais par pragmatisme économique. Un départ mal anticipé coûte cher et une mobilité bien orchestrée sécurise les savoir-faire et fluidifie la transmission.
En encadrant les reconversions internes, l’entreprise gagne en visibilité sur ses forces et ses faiblesses métier.
Elle identifie les compétences à risque, repère les profils capables d’évoluer et prépare à l’avance les relais de croissance. Ce travail d’anticipation est d’autant plus nécessaire dans un contexte où les technologies évoluent plus vite que les fiches de poste.
La montée en compétences devient ainsi un système d’absorption du changement. Les organisations qui l’auront compris ne subiront pas les mutations à venir ; elles les auront déjà intégrées.
Accompagner la reconversion professionnelle de ses collaborateurs
La reconversion n’est plus un cas isolé à gérer à la marge, mais une réalité désormais majoritaire dans les parcours professionnels.
Toujours selon l’étude menée par la Fondation The Adecco Group et l’IFOP, 4 actifs sur 5 envisagent la reconversion comme une opportunité plutôt qu’un échec.
Pourtant, 71 % la perçoivent comme difficile à franchir, faute d’accompagnement structuré. Le paradoxe est là : les salariés sont prêts à évoluer, mais les entreprises ne sont pas toujours prêtes à les guider.
Dans 65 % des cas, les DRH interrogés affirment traiter les demandes de reconversion “au cas par cas”, sans cadre ni processus défini.
Ce mode de gestion opportuniste peut fonctionner à court terme, mais il expose à un risque croissant : perdre des collaborateurs motivés simplement parce qu’ils n’ont pas trouvé d’espace d’évolution interne.
Le nouvel accord sur les reconversions professionnelles signé le 26 juin 2025 pose les premiers jalons d’un cadre plus équilibré. Il ne crée pas de nouveaux droits, mais clarifie les responsabilités de chacun. Le CPF reste sous le contrôle du salarié, qui peut refuser son utilisation dans le cadre d’une mobilité imposée.
Autre avancée majeure : en cas de reconversion externe via un Projet de Transition Professionnelle, le salarié bénéficie désormais d’une garantie de réintégration sur son poste ou sur un poste équivalent en cas d’échec.
Ce filet de sécurité lève l’une des peurs les plus répandues, notamment chez les plus de 50 ans, dont 53 % estiment être “trop âgés” pour se reconvertir.
La reconversion n’est plus une fuite, mais un outil de gestion des compétences
Pour les RH, la question n’est donc plus de “retenir à tout prix”, mais d’organiser les mobilités plutôt que de les subir. Une reconversion peut sauver un talent démotivé, réallouer des compétences sous-utilisées ou anticiper les transformations métiers. À condition d’être encadrée.
Cela suppose de rendre visibles les passerelles possibles, de former les managers à détecter les signaux faibles, et d’ouvrir des espaces de dialogue où un projet de reconversion ne soit plus perçu comme une trahison, mais comme une étape naturelle.
Les entreprises qui auront su intégrer ces transitions dans leurs politiques RH gagneront en agilité. Les autres continueront à voir partir ceux qui auraient pu rester.