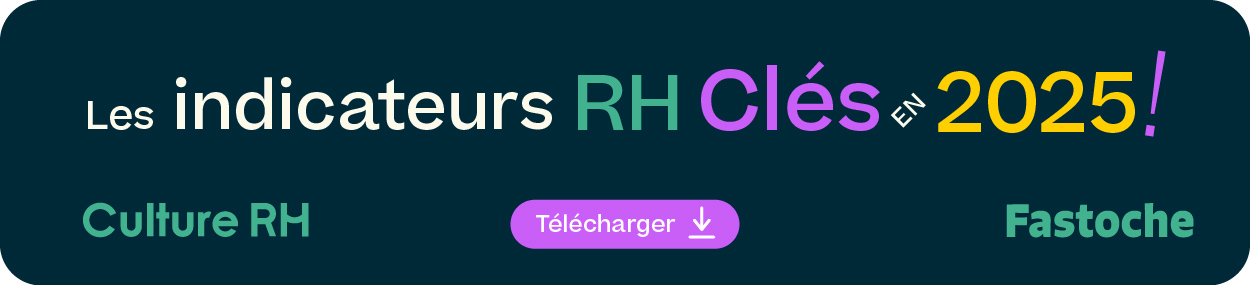Contrat de travail.
Rupture du contrat de travail.
Dans le cadre d’une action en justice portant sur la rupture du contrat de travail, la date de départ de la prescription est la date de rupture du contrat de travail, mais en cas de recours interne ouvert au salarié contre la décision de son employeur, le délai de prescription court à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux.
Cass.soc. 8 septembre 2021 n°19-22.251
Une salariée est licenciée pour faute grave et mise à la retraite d’office. Elle forme un recours gracieux auprès du directeur général de la société qui maintient la sanction puis saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement au titre de la rupture de son contrat de travail.
La Cour d’Appel juge son action prescrite et retient que le point de départ de la prescription est la date de rupture du contrat de travail, date de notification de la lettre de licenciement et que l’introduction d’un recours gracieux devant le directeur général de la société n’étant pas une demande en justice, elle ne saurait avoir ni effet interruptif, ni suspensif sur le cours de la prescription.
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel et précise que le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement court à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux et non à compter de la date de rupture du contrat de travail.
CDD.
Motif de recours.
La réorganisation d’un service comme motif de recours au CDD n’est pas licite.
Cass. soc., 15 septembre 2021, no 19-23.909 F-D
Selon l’article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, lequel doit respecter une liste limitativement fixée.
Un employeur avait fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée de la salariée faisait mention qu’il avait été conclu pour faire face à la réorganisation du service commercial de l’entreprise et que ce motif supposait nécessairement un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et constituait le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur. Elle précise que le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et que la « réorganisation du service commercial » ne peut pas être considérée comme un motif précis suffisant à justifier le recours à un CDD, lorsque les fonctions et missions visées dans la fiche de poste du salarié relevaient « de l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
En conséquence, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
À lire également :
- Reprise anticipée suite à un arrêt maladie, quelles sont les obligations de l’employeur ?
- Accident du travail / de trajet, quelles procédures ?
- Rupture conventionnelle collective, pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Rupture anticipée.
Lorsque l’employeur rompt de manière anticipée le CDD, empêchant par la même son salarié de réaliser la partie variable de sa rémunération, il existe nécessairement un préjudice de perte de chance de percevoir une rémunération complémentaire, lequel ouvre droit à indemnisation.
Cass. Soc. 15 septembre 2021, FS-B, n° 19-21.311
Une société de production signe avec un artiste un contrat à durée déterminée, suivant lequel ce dernier concédait à la société de production l’exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public de ses enregistrements audio et/ou audiovisuels d’œuvres musicales pour le monde entier en vue de la réalisation de trois albums phonographiques, moyennant :
- Le versement d’un salaire par enregistrement.
- De redevances assises sur le produit de la vente des enregistrements et d’avances sur les redevances.
Après la réalisation et la commercialisation du premier album, la société de production rompt le contrat de façon anticipée.
Le salarié saisit les Prud’hommes pour que soit reconnue la rupture abusive de son contrat de travail avant le terme fixé et que lui soient versées les sommes dues en conséquence.
Débouté de sa demande par la cour d’appel, il se pourvoit en cassation.
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’article L. 1243-4 du Code du travail stipule qu’en cas de rupture illicite de la part de l’employeur, le salarié peut obtenir le paiement d’une indemnité dont le montant couvre au minimum l’ensemble des salaires qu’il aurait perçu s’il avait travaillé jusqu’au terme de son contrat ainsi que les indemnités de fin de contrat.
Ce montant ne limite pas le préjudice, dont le salarié peut réclamer réparation, aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits, dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice, et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Si le principe même de l’indemnisation ne pose pas de problème, il en va différemment lorsque l’on s’intéresse à la nature du dommage ainsi qu’à l’évaluation du préjudice subi. Cette difficulté s’observe notamment lorsque le salarié bénéficie d’un mode de rémunération variable.
Contrat à temps partiel.
Requalification du contrat à temps partiel.
Un salarié à temps partiel ne doit jamais travailler au-delà de la durée légale hebdomadaire. L’atteinte et le dépassement de la durée légale de travail de 35 heures, sur une semaine, entraînent la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563.
Un salarié est engagé selon un contrat de travail à temps partiel d’une durée mensuelle de 50 heures de travail effectif par mois.
Au cours de la première semaine d’un mois, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail, soit plus de 35 heures (1,75 heure au-delà). La durée de travail contractuelle mensuelle était quant à elle restée inchangée sur le mois litigieux.
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que le salarié qui travaille à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, mais que celles-ci ne doivent pas porter sa durée du travail au-delà de 35 heures. À défaut, le salarié est considéré comme travaillant à temps plein. Il importe peu que l’horaire mensuel soit resté inchangé sur le mois en question.
La requalification en contrat à temps plein est encourue, en cas d’atteinte ou de dépassement, même faible, des 35 heures.
Cette règle est d’ordre public.
Ainsi, lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de la réalisation d’heures complémentaires, atteint la durée légale de travail, il peut solliciter la requalification de son contrat de travail en temps plein.
Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation invite au suivi rigoureux de la durée du travail des salariés à temps partiel mensuel. Si du fait de l’activité, le salarié est susceptible d’effectuer des heures complémentaires, il peut être utile de créer deux compteurs d’heures : un compteur hebdomadaire et un compteur mensuel, qui ne doivent jamais atteindre la durée légale de travail (ou conventionnelle si elle est inférieure).
À lire également :
- Le compte épargne-temps, mode d’emploi.
- Pause déjeuner, quelles obligations pour l’employeur ?
- Plan de prévention, définition, utilité, rédaction, … Tout savoir !
Pouvoir disciplinaire.

Une convention collective peut subordonner le prononcé du licenciement à l’existence de sanctions antérieures pouvant être notamment une observation. Dans ce cas, cette sanction étant de nature à avoir une incidence sur la présence dans l’entreprise du salarié au sens de l’article L 1332-2 du Code du travail, l’employeur est tenu de respecter la procédure disciplinaire prévue par les dispositions L 1332-2 et de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Le sommet QVCT 2025
Dernières places : le 5 juin 2025, trois acteurs de la QVCT (Wellpass (ex Gymlib), Alan et Welcome to the Jungle) se réunissent pour challenger les pratiques RH en matière de qualité de vie au travail. Faites partie des 1000 RH qui ont déjà répondu présents.
Je m’inscris gratuitementCass. Soc. 22 septembre 2021 n°18-22204
Une association licencie un salarié pour faute grave, après lui avoir envoyé deux lettres d’observation valant sanctions disciplinaires. Mais le salarié conteste : la convention collective applicable à l’association prévoit que lorsque l’employeur envisage de prononcer une sanction, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable, sauf si la sanction n’a pas d’incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En l’espèce, il n’a jamais été convoqué à un entretien préalable avant d’être sanctionné, alors même que les sanctions en cause avaient une incidence sur sa présence dans l’entreprise. Le salarié demande donc que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt de la Cour de cassation donne tort au salarié et déclare que, le fait que l’employeur n’ait pas respecté la procédure prévue par la convention collective, est suffisant pour obtenir l’annulation des deux sanctions, mais ne lui permet pas, néanmoins, d’obtenir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation apporte une précision sur l’obligation d’organiser un entretien préalable avant de prononcer un avertissement ou une sanction de même nature.
En principe, un employeur n’est pas tenu d’organiser un entretien préalable lorsqu’il prononce un avertissement dans la mesure où cette sanction n’a pas d’incidence sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Toutefois, cette obligation s’impose lorsque les dispositions d’une convention collective conditionnent le licenciement à l’existence de sanctions antérieures.
Dans ce cas, chaque sanction disciplinaire doit être précédée d’un entretien préalable.
À défaut, la sanction disciplinaire en cause peut être annulée par le juge, ce qui peut aboutir à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui s’appuie sur cette sanction.
Rémunération.
Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut pas permettre à un employeur de modifier le contrat de travail d’un salarié sans recueillir son accord exprès.
Soc. 15 sept. 2021, FS-B, n°19-15.732
Un salarié est embauché en CDI par une chaîne publique de télévision en contrepartie d’une rémunération forfaitaire sans prime ni indemnité.
Quelques années plus tard, un accord collectif est conclu, en vertu duquel la rémunération du salarié est divisée en un salaire de base dont le taux est diminué pour y intégrer une prime d’ancienneté. Un avenant est transmis au salarié pour l’informer de ce changement.
Le salarié conteste l’avenant et saisit le conseil de prud’hommes afin de faire constater que son employeur lui impose, sans son accord, une nouvelle structure pour sa rémunération. Il réclame des rappels de salaire et sa prime d’ancienneté prévue initialement.
Les juges du fond ainsi que la cour d’appel donnent raison au salarié.
L’employeur se pourvoit en cassation en argumentant que la structure de la rémunération n’est pas fixée par le contrat de travail et qu’elle peut donc être modifiée sans l’accord du salarié.
La Cour de cassation constate que le contrat de travail, ses avenants ainsi que des bulletins de salaire établis avant l’application de l’accord collectif déterminent une rémunération forfaitaire brute mensuelle du salarié et, qu’à compter de cet accord, cette rémunération a été scindée en un salaire de base dont le taux était diminué pour y ajouter et intégrer la prime d’ancienneté. Le mode de rémunération contractuelle de l’intéressé avait été ainsi modifié dans sa structure sans son accord.
Elle rejette le pourvoi en confirmant que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié.
Cette décision confirme une jurisprudence constante en matière de rémunération et rappelle que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l’accord du salarié, même si la modification est plus avantageuse pour lui.