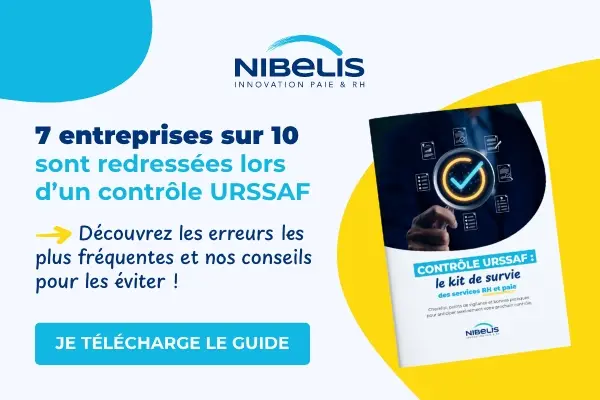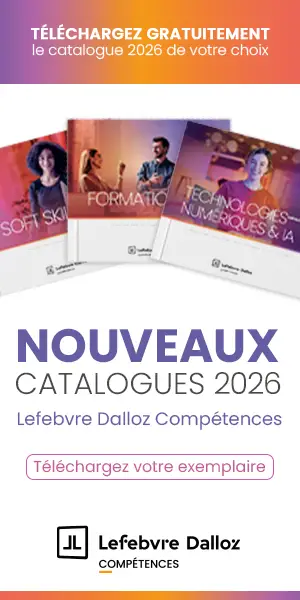Entre flexibilité, charge de travail et santé des salariés, la question de l’amplitude horaire représente un enjeu central pour les employeurs.
L’amplitude horaire, à ne pas confondre avec travail effectif ou durée légale du travail, recouvre la totalité de la journée du salarié, de sa prise de poste le matin à sa fin de journée le soir, pauses incluses.
Mais jusqu’où peut-on aller ? Existe-t-il une amplitude horaire maximale ? Quelles limites la loi impose-t-elle ? Et comment prévenir les risques liés à des amplitudes trop longues ?
Qu’est-ce que l’amplitude horaire ?
Définition
Le Code du travail ne définit pas la notion d’amplitude horaire légale, c’est la jurisprudence qui l’encadre.
L’amplitude horaire correspond à la période comprise entre la prise de poste d’un salarié et la fin de sa journée de travail. Elle englobe donc le temps de travail effectif du salarié et les différents temps de pause de la journée, y compris la pause déjeuner.
Exemple : si un salarié travaille de 8h à 12h puis de 14h à 18h avec deux heures de pause, son amplitude horaire va de 8 heures à 18 heures, elle est donc de 10 heures.
En France, sauf conventions spécifiques à certaines professions, l’amplitude horaire maximale est de 13 heures. À défaut de règle écrite, l’amplitude est encadrée par la jurisprudence.
L’amplitude horaire du travail se calcule en principe sur une journée civile, c’est-à-dire le même jour entre 0 h et minuit. Elle ne peut donc pas être à cheval sur 2 jours.
A lire également :
- Logiciel gestion du temps : Les 15 meilleures solutions
- Chômage après un CDD : règles et conditions
- Réserves sur un accident du travail : ce que dit la loi + exemples
Distinctions
L’amplitude horaire se distingue de la durée légale de travail
La durée légale de travail, c’est-à-dire la durée maximale de travail quotidien, est fixée, dans le cas général, à 10 heures par jour. Ces 10 heures de travail effectif doivent être réparties dans le créneau d’amplitude horaire de 13 heures.
L’amplitude horaire se distingue aussi du temps de travail effectif.
À la différence de l’amplitude horaire qui intègre tout le temps de présence sur la journée, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. (article L.3121-1 du Code du travail).
L’amplitude horaire va donc au-delà du travail effectif. Pour rappel, les temps d’habillage, de déshabillage ou de déplacement professionnel sont inclus dans le temps de travail effectif.
Si l’on reprend notre exemple précédent, l’amplitude horaire est de 10 heures, alors que la durée de travail effective n’est que de 8 heures.
Cette distinction est essentielle, car c’est l’amplitude horaire qui permet de vérifier que les repos quotidiens et hebdomadaires, garantis par le Code du travail, sont bien respectés.
Quelle est l’amplitude horaire maximale autorisée?
Le principe général : une amplitude maximale légale de 13 heures par jour
Le Code du travail ne fixe pas directement une “amplitude horaire maximale”, en revanche, il impose un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail).
En effet, le calcul de l’amplitude horaire doit être réalisé à partir du temps de repos, défini par la Loi, dont tout salarié doit légalement bénéficier, à savoir 11 heures consécutives de repos par jour.
Concrètement, cela signifie que sur une journée de 24 heures, un salarié ne peut pas avoir une amplitude supérieure à 13 heures (24 h – 11 h = 13 h). C’est la limite légale maximale. Il n’existe pas d’amplitude horaire minimale.
Autrement dit, si un salarié quitte son poste à 22 h, il doit bénéficier de 11 h de repos et ne peut pas reprendre avant 9 h le lendemain. À défaut, une infraction est constituée.
De même, s’il débute sa journée à 7h, il doit avoir quitté son travail au plus tard à 20h. Au-delà, ce serait constitutif d’une infraction.
C’est la prise de poste du salarié qui marque le début du décompte de l’amplitude journalière de travail. Le pointage de l’heure de travail, s’il existe, est donc un élément important pour contrôler le respect de l’amplitude horaire des salariés.
La disposition relative au repos quotidien est d’ordre public. Cela signifie que l’amplitude horaire qui en découle est strictement encadrée afin de prévenir les abus.
Pour les salariés en forfait jours, bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte de leurs heures de travail, l’employeur doit tout de même prendre en compte leur amplitude horaire maximale et s’assurer que leur charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
Des dérogations strictement encadrées
Il existe plusieurs exceptions au principe général d’amplitude horaire maximale.
L’exception liée au travail de nuit
la règle générale en vigueur pour le calcul de l’amplitude horaire ne s’applique pas au travail de nuit.
La base de calcul de la journée ne peut pas être utilisée puisque les heures de travail de nuit s’effectuent entre deux journées.
La loi prévoit que les postes de nuit commencent à partir de 21 heures et doivent s’achever au plus tard à 7 heures. Leur amplitude horaire de travail entre soir et matin est de 10 heures maximum, avec une plage obligatoire entre minuit et 5 h.
Le travail de nuit doit être régi par un accord collectif.
Les exceptions liées aux spécificités des métiers et de leurs contraintes horaires.
Dans les secteurs d’activité, où la continuité du service est nécessaire, (santé, hôtellerie, restauration, transport…), des règles dérogatoires peuvent s’appliquer, pour lesquelles il est essentiel de consulter les conventions collectives en vigueur.
En effet, certaines conventions collectives ou accords d’entreprise peuvent prévoir des amplitudes supérieures à l’amplitude légale.
Mais ces dérogations doivent toujours garantir :
- Le respect des temps de repos minimaux.
- Une compensation équivalente en cas de réduction du repos.
- Et un suivi rigoureux de la santé et de la charge de travail.
Par exemple, dans la convention collective des hôtels et cafés restaurants (HCR), les durées maximales journalières sont différentes, de même que le nombre d’heures de repos consécutives.
Ainsi, au lieu des 11 heures légales, certains salariés de la restauration ont droit à 12 heures de repos consécutives en fonction de l’heure de fin de leur service. Dans ce cas, l’amplitude horaire maximale est donc de 12 heures.
Autre secteur traditionnellement dérogatoire au principe de l’amplitude horaire : le transport routier. Le Code des transports prévoit que les chauffeurs routiers bénéficient d’une amplitude horaire maximale de 12 heures, avec des temps de pause allant de 15 à 45 minutes.
Par exception, elle peut aller au-delà des 12 heures pour les ambulanciers, mais elle est diminuée à 10 heures pour les coursiers.
Dans les établissements sociaux ou médico-sociaux de droit privé à but non lucratif, l’amplitude horaire quotidienne peut atteindre 15 heures.
Dans le commerce de détail, elle est en revanche limitée à 10 heures.
Enfin, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, une dérogation peut être faite au temps de repos quotidien et donc, par conséquent, à l’amplitude horaire.

Le cas du télétravail
Depuis la généralisation du télétravail, la notion d’amplitude horaire s’est élargie à la connexion numérique.
De nombreux salariés prolongent leur journée de travail par des mails ou réunions à distance, sans s’en rendre compte.
La jurisprudence récente rappelle que :
- Les temps de déconnexion doivent être respectés.
- Le salarié ne peut pas être sanctionné pour ne pas répondre en dehors de ses horaires habituels.
- Et les connexions tardives peuvent être assimilées à une atteinte au droit au repos.
Les entreprises doivent donc être vigilantes dans la maîtrise de l’amplitude horaire de leurs salariés en télétravail et inclure dans leurs accords sur le télétravail un droit à la déconnexion effectif (article L.2242-17 du Code du travail).
Les risques du non respect de l’amplitude horaire légale
Une atteinte au droit au repos et à la santé du salarié
L’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés (articles L.4121-1 et suivants du Code du travail).
En laissant un salarié travailler sur de trop longues plages horaires, il l’expose à une fatigue excessive, un risque accru d’accident et, plus largement, à des risques psychosociaux.
De plus, le salarié peut faire valoir :
- Une atteinte à sa santé.
- Un non-respect du repos quotidien.
- Voire un travail dissimulé si les heures ne sont pas correctement comptabilisées.
L’entreprise peut être condamnée à des dommages et intérêts pour atteinte à la santé, et, dans les cas graves, la faute inexcusable peut être retenue en cas d’accident du travail.
Le paiement des heures supplémentaires
Un autre risque encouru par un employeur qui ne respecterait pas l’amplitude horaire serait de devoir payer des heures supplémentaires aux salariés concernés.
Les sanctions possibles pour l’employeur
Enfin, en cas de non-respect des durées maximales de travail ou des temps de repos, l’employeur risque d’être condamné à payer des dommages-intérêts, selon la gravité des faits.
Le non-respect des règles relatives à l’amplitude horaire revient à ne pas respecter les règles relatives au repose quotidien. Pour rappel, le fait de ne pas faire bénéficier un salarié de son repos quotidien est sanctionné par une contravention de 4ème classe, qui entraîne une amende de :
- 135€ (montant forfaitaire).
- 750€ maximum s’il s’agit d’une personne physique.
- 3750€ s’il s’agit d’une personne morale.
Ces contraventions sont multipliées autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés.
S’il y a dépassement des horaires, l’employé peut saisir l’inspection du travail, et demander par la suite des dommages et intérêts en établissant la réalité du préjudice qu’il a subi.
A lire également :
- Heure de nuit: à partir de quelle heure ? règles, majoration et exemples
- La modulation du temps de travail : exemple, refus, avantages et inconvénient
- Imposer des congés payés 2025 : règles, délais et droits du salarié