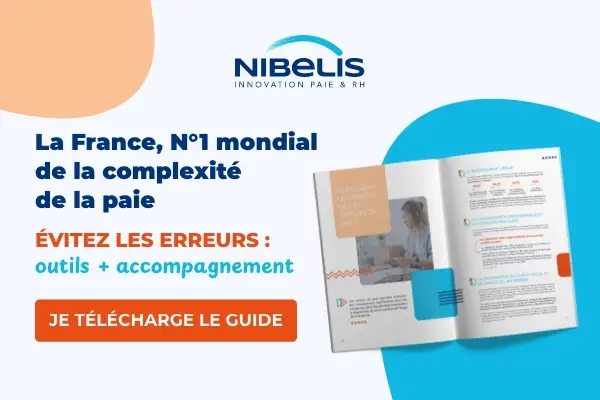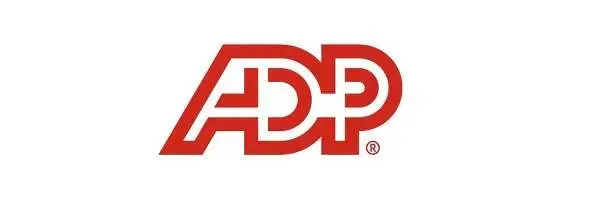Les interruptions de carrière, une tendance durable
Une récente étude de LiveCareer, menée sur près de 10 millions de CV français, s’est penché sur l’ampleur du phénomène des interruptions de carrière.
Et les chiffres confirment une forte hausse : entre 2020 et 2025, toutes les catégories de pauses professionnelles ont progressé, qu’elles durent un mois ou plus d’un an. Ce constat illustre une transformation durable du marché du travail.
En 2025, 39 % des candidats présentent une interruption de carrière d’au moins 12 mois. Ce chiffre était de 34 % seulement quelques années plus tôt. Les pauses courtes suivent la même tendance, puisque 61 % des CV affichent au moins un mois d’inactivité.
Les parcours linéaires sont de plus en plus rares : moins de 40 % des candidats peuvent désormais se prévaloir d’un CV sans interruption. La pandémie a joué un rôle déclencheur, mais d’autres facteurs renforcent cette dynamique.
Licenciements, reconversions professionnelles ou nouvelles attentes personnelles contribuent à multiplier ces arrêts.
Pour les candidats, expliquer ces périodes devient une étape clé dans le processus de recrutement. Les recruteurs, de leur côté, doivent accepter que la discontinuité soit la norme et non l’exception.
Le marché du travail s’oriente vers une vision plus inclusive, où la valeur se mesure davantage aux compétences qu’à la continuité d’un parcours.
Sanctionner un salarié : les 10 règles d’or à connaître
Avertissements, blâmes, mises à pied... Chaque sanction disciplinaire expose l’employeur à un risque juridique. Ce livre blanc gratuit proposé par notre partenaire les Éditions Tissot vous aide à sécuriser vos pratiques grâce à 10 conseils essentiels.
Je télécharge gratuitementA lire également :
- 7 leviers pour remobiliser ses équipes au retour des congés d’été
- Salarié bloqué à l’étranger pendant ses congés : que dit la loi ?
- Congés et flexibilité : où en est-on ?
Mieux gérer les interruptions de carrière dans les pratiques RH
Face à cette évolution, candidats et employeurs doivent adapter leurs approches. Pour un chercheur d’emploi, il ne s’agit plus de masquer une période d’inactivité, mais de la transformer en atout.
Une pause peut être présentée comme une opportunité de développement, qu’il s’agisse d’une formation, d’un projet personnel ou d’une réorientation.
Les CV et lettres de motivation doivent désormais refléter cette réalité. Des outils numériques spécialisés permettent d’expliquer clairement une transition sans donner l’impression d’un « trou » dans le parcours.
Les conseils carrière insistent sur l’importance de valoriser les compétences acquises en dehors du cadre strictement professionnel.
Pour les entreprises, l’enjeu est d’adapter leurs pratiques de recrutement. Plus de la moitié des candidats ont connu une interruption récente : ignorer ces parcours reviendrait à passer à côté de profils qualifiés.
Repenser le processus signifie évaluer les candidats sur leurs acquis réels, leur potentiel et leur capacité d’adaptation.
Les RH ont également un rôle d’accompagnement en interne. Les salariés qui reviennent après une longue pause ont besoin d’une intégration spécifique.
Cela peut passer par des programmes de formation ciblés, un mentorat ou une adaptation progressive des responsabilités. Ces pratiques renforcent la fidélisation et participent à une culture d’entreprise inclusive.
A lire également :
- Congés payés, maternité,… Quels congés dans le secteur privé ?
- Comment compter les jours d’arrêt maladie ?
- Congés illimités, vraie bonne idée ou doux fantasme ?