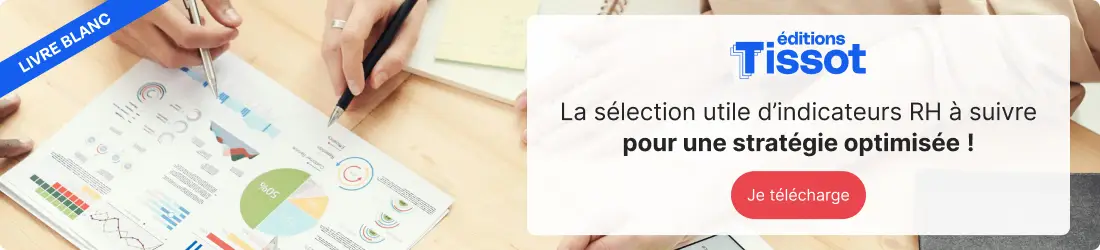Des managers plus en souffrance en 2025 ?
Le management n’est plus perçu comme une promotion en 2025. Il est vécu comme une course sans pause où les priorités changent chaque heure.
Selon l’étude Factorial et Beyond Research Group, 83 % des managers français estiment que leur charge de travail détériore la relation avec leur équipe.
Ils passent près de la moitié de leur temps sur des tâches administratives répétitives. Ils aimeraient accompagner les collaborateurs mais se retrouvent absorbés par des flux d’e-mails et des tableaux Excel.
Le phénomène touche toute l’Europe. En Italie, au Portugal ou en Allemagne, les mêmes signaux apparaissent. En France, 40 % des projets échouent à cause d’un manque d’organisation interne.
Le manager doit rattraper les défaillances structurelles sans moyens adaptés. Il éteint les urgences au lieu de construire une trajectoire claire.
Le manque de données fiables renforce cette fatigue. 43 % des managers français affirment que leur entreprise a déjà perdu de l’argent à cause d’informations obsolètes.
Malgré cela, 80 % continuent de prendre des décisions à l’instinct. Ils pilotent sans repères concrets, ce qui augmente la charge mentale. La crainte de se tromper devient permanente.
Quand le stress déborde sur la vie personnelle
La frontière entre vie professionnelle et vie privée disparaît. 62 % des managers français travaillent au-delà de leur temps contractuel. Le travail se poursuit le soir, le week-end, parfois même pendant les congés. Beaucoup expliquent ne plus réussir à décrocher mentalement.
Cette situation influence les ambitions. Selon un récent baromètre APEC, seuls 39 % des cadres souhaitent encore accéder à un poste de management.
Une étude OpinionWay pour Indeed indiquait déjà que 25 % des femmes cadres refusaient d’encadrer une équipe. Prendre des responsabilités n’est plus un objectif naturel. C’est une décision risquée.
Certains parlent d’un rôle piégé. Ils doivent être stratèges, psychologues et techniciens dans la même journée. Ils doivent décider vite mais avec peu d’informations.
Ils doivent écouter les émotions des autres mais taire les leurs. Selon Factorial, 26 % estiment que leur poste ne correspond pas aux promesses initiales. Ils pensaient manager des humains mais se retrouvent à gérer des process.
Pourtant, une issue existe. 79 % des managers se disent prêts à s’impliquer davantage s’ils étaient déchargés de certaines tâches. Le problème n’est pas la motivation. Il réside dans les conditions de travail.
Collaboration, participation et coopération au coeur des attentes
Le management évolue vers plus d’écoute et de respect en 2025. Selon la troisième édition du Baromètre des Soft Skills menée par LégiSocial et TodoSkills, les salariés attendent d’abord un manager humain et structuré. L’écoute active est citée comme compétence prioritaire par 92 % des répondants.
L’intelligence émotionnelle s’impose aussi comme une compétence centrale dans le management moderne. Elle est jugée prioritaire par 55,5 % des femmes et 37,8 % des hommes, preuve que la perception de la gestion des émotions varie selon les profils.
Cette capacité à comprendre, réguler et accueillir les ressentis, les siens comme ceux des autres, devient un levier de confiance collective.
Dans un environnement de travail où cohabitent plusieurs générations et où les attentes de reconnaissance s’intensifient, l’intelligence émotionnelle sert de langage commun.
Elle permet d’éviter les conflits intergénérationnels, d’apaiser les tensions liées aux stéréotypes et de mieux accompagner des situations sensibles, comme la surcharge mentale des parents salariés.
Plus qu’un trait de personnalité, c’est une compétence stratégique : les entreprises qui la valorisent créent des équipes plus résilientes, plus loyales et plus engagées.
Le respect progresse fortement cette année selon la même étude. Il devient la qualité la plus valorisée devant la capacité à accepter un feedback. Les salariés veulent des relations équitables, sans jugement ni hiérarchie autoritaire.
La responsabilité arrive juste après dans le classement. 78,5 % des répondants attendent un manager capable d’assumer ses décisions. Le professionnalisme progresse aussi, signe d’une attente de fiabilité.
Kit pratique RH : formation des managers aux RPS
En 2025, près d’un collaborateur sur deux déclare une détresse psychologique, entraînant une hausse de l’absentéisme. Les managers, en première ligne, manquent de formation et de ressources. Pour y remédier, notre partenaire Lucca propose un kit pratique dédié à la prévention des RPS. Il comprend 5 modules de formation, des mises en situation, 3 ressources actionnables ainsi qu’une vidéo d’Adrien Chignard présentant la méthode des 3i pour détecter les collaborateurs en souffrance. Ce kit pratique a été réalisé par notre partenaire Lucca.
Je télécharge le kitLes compétences méthodologiques entrent dans le top 12 pour la première fois. Les équipes apprécient les managers capables d’organiser sans étouffer. Elles ne veulent plus d’improvisation permanente.
La coopération devient un critère fort. La résolution de problèmes reste essentielle selon le baromètre. L’ouverture à la nouveauté est également citée.
Certaines compétences reculent, comme la curiosité ou l’attitude positive. Ce changement montre un recentrage vers des qualités plus concrètes. Les salariés préfèrent un manager cohérent plutôt qu’un manager enthousiaste mais instable.
Le manque de collaboration fait perdre du temps et de la motivation
Une étude menée par Figma et OpinionWay révèle un autre problème. Près de 20 % du temps de travail des managers est perdu chaque semaine à cause d’un manque de collaboration entre équipes. Cela représente environ huit heures gaspillées selon les répondants.
Plus de 50 % des managers déclarent manquer de reconnaissance dans les projets collaboratifs. Les salariés ressentent aussi ce manque, même si leur frustration est légèrement moindre. La coopération partielle génère des tensions silencieuses.
Les conflits entre équipes commerciales sont cités comme un frein par 60 % des managers. Ils estiment que ces tensions impactent directement leur performance. Chaque désaccord fait perdre du temps et de l’énergie.
Les outils numériques apparaissent comme une solution partielle. Selon l’étude, ils permettent de gagner dix heures par mois en moyenne. Le partage de documents et la communication en temps réel facilitent les échanges.
Cependant, la technologie ne suffit pas. 20 % des managers estiment que les outils actuels ne sont pas adaptés à leurs besoins. Cette proportion monte à 29 % chez les 30-39 ans.
Ces chiffres rejoignent les attentes observées dans d’autres études. Selon le baromètre “L’entreprise de demain” réalisé par OpinionWay pour la CG Scop, 51 % des salariés souhaitent être davantage associés aux décisions stratégiques. 60 % des dirigeants partagent cette volonté.
IA et Management : amis ou ennemis ?
L’intelligence artificielle s’impose peu à peu dans toutes les fonctions de l’entreprise. Elle n’épargne pas le management, qui voit ses méthodes profondément transformées. Les dirigeants doivent apprendre à travailler avec ces nouveaux outils sans perdre leur rôle humain.
L’IA peut devenir un puissant allié pour les managers. Elle automatise les tâches répétitives et libère du temps. Elle fournit aussi des analyses utiles pour comprendre une équipe ou anticiper une baisse de performance. Mais son intégration soulève une question centrale.
Comment utiliser ces outils sans tomber dans une surveillance excessive ? Comment garder la confiance des collaborateurs si chaque décision semble dictée par un algorithme ?
Selon une étude du Boston Consulting Group, la France fait partie des pays les plus méfiants face à l’IA en entreprise. Les managers doivent donc rassurer et expliquer clairement leurs intentions. L’outil ne doit pas remplacer le jugement humain mais le renforcer.
La transparence devient une règle essentielle. Il faut expliquer ce que fait l’IA, avec quelles données et dans quel but. Cette pédagogie évite les fantasmes et favorise l’adhésion.
L’IA ne doit pas servir uniquement à mesurer ou contrôler. Elle doit aussi aider à mieux reconnaître les efforts. Un manager peut par exemple détecter plus vite un risque de surcharge ou un besoin de formation. L’outil devient alors un soutien plutôt qu’un radar.
Le leadership évolue vers un équilibre entre technologie et empathie. Le manager doit savoir exploiter la donnée tout en préservant la relation humaine. Il devient un facilitateur plus qu’un donneur d’ordres.
Le travail hybride : plus du tout une option (surtout pour les plus jeunes)
Le modèle hybride s’impose désormais dans les stratégies de management. Selon IWG, 73 % des salariés quitteraient une entreprise sans flexibilité. 67 % des recruteurs constatent plus de démissions liées aux politiques de retour obligatoire.
Le travail hybride améliore productivité et motivation. Il remplace le 9 h–18 h par une logique de résultats. Les trajets réduits renforcent l’équilibre de vie et la fidélisation.
Les gains financiers sont significatifs. Selon une étude d’IWG, des économies annuelles peuvent atteindre 30 000 dollars. Pour de jeunes salariés, c’est un signal fort en période d’inflation.
Le modèle soutient aussi la parité. Deux tiers des femmes le jugent essentiel pour accéder à des postes de direction. La flexibilité facilite la progression sans renoncer aux responsabilités familiales.
Les jeunes salariés imposent de nouvelles normes d’attractivité
Pour les jeunes diplômés, la flexibilité est décisive. Toujours selon IWG, 67 % n’envisagent pas un poste sans travail hybride. Ils estiment ce modèle équivalent à une hausse salariale de 13 %.
Les attentes sont claires. IWG indique que 96 % plébiscitent la flexibilité géographique. 69 % refuseraient un emploi avec longs trajets et cinq jours sur site.
Le marché valide cette tendance. Selon le Global Workforce Report de Remote, 71 % des recruteurs ont perdu des talents au profit d’entreprises plus flexibles. 85 % observent une forte hausse de l’intérêt pour ces modèles.
La flexibilité nourrit la performance. Toujours selon Remote, 35 % des entreprises constatent de meilleurs résultats commerciaux. En France, 79 % des entreprises internationales ont augmenté leurs effectifs avec l’hybride.
Management intergénérationnel et parentalité : deux enjeux majeurs de 2025
Quatre générations cohabitent désormais au travail. Le défi n’est plus la cohabitation polie, mais la coopération utile. Les managers doivent transformer la diversité en performance durable.
Transformer la cohabitation des âges en avantage compétitif
Selon une étude Indeed et YouGov, 66 % des salariés voient toutes les générations représentées. 62 % des recruteurs font le même constat. La pluralité est là, mais la collaboration reste perfectible.
Les plus âgés sont mieux perçus qu’on ne le pense. 75 % des salariés valorisent l’expérience des seniors. 65 % reconnaissent leur rôle de mentor. 54 % estiment que la génération Z apporte des perspectives nouvelles.
Les jeunes, quant à eux, peuvent accélérer l’adoption technologique. 59 % des salariés et 67 % des recruteurs saluent leurs compétences numériques.
Mais les stéréotypes freinent encore la coopération. 62 % des salariés jugent les jeunes moins engagés et 57 % estiment les seniors moins adaptables aux technologies.
Le levier prioritaire reste le partage structuré de connaissances. 52 % des salariés et 51 % des recruteurs le citent, selon Indeed et YouGov. L’OCDE rappelle pourtant que les 55-65 ans se forment deux fois moins.
Les managers doivent donc organiser des binômes croisés et des parcours communs. Les seniors transmettent le métier et les juniors diffusent les usages digitaux. La mixité d’âges devient alors un moteur d’apprentissage continu.
Parentalité au travail : urgence d’un cadre réellement soutenant
Selon l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise, 89 % des salariés sont parents ou aidants. Mais un parent sur trois déclare une trajectoire pénalisée. 43 % des femmes rapportent un impact de carrière : 17 % ont réduit leur temps de travail, 13 % ont refusé une évolution, et 3 % une augmentation.
La charge mentale reste le point aveugle. 57 % des parents ressentent une surcharge liée au travail et 60 % n’ont bénéficié d’aucune mesure d’aide.
Le présentiel rigide alourdit la facture. Selon une étude de Remote, les parents dépensent 493 euros par semaine pour la garde. 80 % anticipent une hausse des coûts si le retour au bureau s’intensifie.
Les politiques RTO (pour Recovery Time Objective) ont déjà des effets négatifs : 71 % des répondants en constatent, et 63,5 % ont envisagé de démissionner. 73 % ont demandé des modalités flexibles à leur employeur.
Les cadres parents sont particulièrement exposés. Selon l’Apec, 37 % peinent à concilier les vies et 61 % retravaillent le soir, signe d’une flexibilité sous pression.
L’égalité reste inachevée. L’Apec observe une charge inégale pour les mères cadres, plus souvent sollicitées. L’issue passe par des droits effectifs et des dispositifs individualisés.
La réponse du management doit être claire. Flexibilité organisée, soutien psychologique, solutions de garde et communication transparente. Sans cela, l’entreprise perdra rapidement des talents clés.