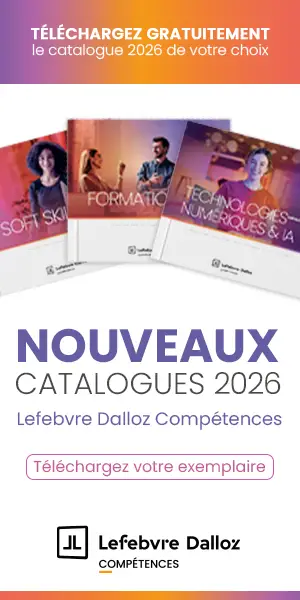Un marché de l’emploi plus souple, résilient et inclusif
Le marché du travail français traverse une phase charnière avec des recrutements qui ralentissent et des intentions d’embauche qui atteignent leur plus bas niveau depuis quatre ans.
Selon le dernier baromètre Apec, seules 8 % des entreprises prévoient d’embaucher des cadres au troisième trimestre 2025, un taux historiquement faible.
De l’autre, les salariés se montrent paradoxalement plus mobiles : toujours selon l’Apec, 15 % des cadres envisagent un changement d’entreprise à court terme, tandis que 31 % se déclarent ouverts à toute opportunité.
Dans ce contexte mouvant, la flexibilité devient une nécessité stratégique. Selon l’étude LinkedIn, 85 % des professionnels RH déclarent ressentir une pression accrue pour atteindre leurs objectifs, principalement en raison du manque de candidats qualifiés.
Pour y répondre, les directions RH misent davantage sur des formats d’embauche plus adaptables : contrats courts, collaborations hybrides, ou encore recours sélectif aux freelances.
Cette diversification des modes de travail dessine un marché plus souple, capable d’absorber les fluctuations sans bloquer les organisations.
Mais la transformation ne se joue pas uniquement sur l’efficacité. Selon le baromètre Leboncoin Emploi, la progression de la transparence salariale et des demandes de flexibilité témoigne d’une attente forte en matière d’équité et d’individualisation.
Miser sur l’inclusion, qu’elle soit sociale, générationnelle ou contractuelle, devient dès lors un levier de performance autant qu’un marqueur d’attractivité.
Apprentissage et Professionnalisation : ce qui a changé en 2025
L’année 2025 marque un tournant pour les contrats en alternance.
Selon les dernières annonces gouvernementales, l’aide à l’embauche d’apprentis est maintenue, mais revue à la baisse.
Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient désormais de 5 000 €, contre 6 000 € auparavant, tandis que les structures de 250 salariés et plus ne perçoivent plus que 2 000 €, à condition d’atteindre 5 % d’alternants dans leurs effectifs.
Cette réduction reste toutefois perçue comme un compromis acceptable, tant l’apprentissage répond à un besoin critique de main-d’œuvre qualifiée.
Une autre évolution majeure s’est ajoutée le 1er juillet. Selon le décret présenté par France Compétences, les employeurs doivent désormais assumer un reste à charge forfaitaire de 750 € pour chaque apprenti préparant un diplôme de niveau bac + 3 et plus.
Ce montant est directement versé au CFA et fractionné en plusieurs étapes, ce qui complexifie les démarches administratives mais responsabilise davantage les entreprises.
En parallèle, les contrats de professionnalisation perdent du terrain. Selon une analyse d’Indeed, leur volume a reculé de 12 % en un an, tandis que l’apprentissage a bondi de 14 %. La suppression prochaine de l’aide de 6 000 € depuis mai 2024 pour ces contrats risque d’accélérer cette tendance.
Mais des aides de France Travail sont encore possibles : un employeur qui recrute un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus en contrat de professionnalisation peut bénéficier d’une aide forfaitaire de 2 000 euros pour un salarié à temps plein.
Résultat : l’alternance se recentre sur l’apprentissage, désormais considéré comme la voie prioritaire d’insertion. Aux entreprises de s’adapter à ce nouveau cadre, en arbitrant entre coût, attractivité et capacité à fidéliser les jeunes talents.
IA et recrutement : entre gain d’efficacité et défi de confiance
L’intelligence artificielle s’impose désormais comme un outil incontournable pour les recruteurs.
Une enquête HelloWork nous apprend que 79 % des professionnels RH ont recours à l’IA générative pour rédiger des offres, qualifier des candidatures ou automatiser le suivi administratif.
L’objectif est clair : gagner du temps sur les tâches répétitives pour se concentrer sur l’humain. Cette technologie devient aussi un rempart contre la fraude, alors qu’un candidat sur quatre pourrait bientôt présenter un profil falsifié.
La résilience passe également par la technologie. Toujours selon LinkedIn, 97 % des recruteurs estiment que l’IA leur fait gagner un temps précieux.
Automatisation du tri de candidatures, matching intelligent, tableaux de bord RH renforcés… L’IA permet aux équipes de redéployer leurs efforts vers la relation candidat, la mobilité interne ou encore la fidélisation.
Mais si les recruteurs y voient un levier d’efficacité, les candidats restent méfiants. Selon une étude Gartner, seuls 26 % estiment que l’IA garantit une évaluation juste.
Près d’un tiers redoutent même qu’un algorithme élimine leur candidature à tort. Pour eux, la technologie introduit une forme d’opacité : le sentiment que leur dossier est trié par une “boîte noire” plutôt que par un recruteur réel.
Un quart des répondants déclarent d’ailleurs faire moins confiance aux employeurs qui automatisent leurs sélections.
Le paradoxe est frappant. Toujours selon Gartner, 39 % des candidats utilisent eux-mêmes l’IA pour rédiger un CV ou une lettre de motivation, mais s’inquiètent dès qu’elle est utilisée pour les évaluer. L’outil est accepté comme assistant personnel, pas comme arbitre.
Face à ce fossé, la réponse ne peut être uniquement technologique. La clé réside dans la transparence.
Expliquer le rôle de l’IA, préciser ce qui est automatisé ou non, et maintenir un contact humain visible restent les meilleurs moyens de préserver la confiance. L’efficacité ne suffira pas : c’est l’équité perçue qui fera la différence.
Des offres d’emploi qui déçoivent et des diplômes qui ne servent plus à rien ?
Le marché de l’emploi évolue plus vite que les pratiques de recrutement. Les candidats ne se contentent plus d’une description vague : ils attendent un discours sincère, réaliste et cohérent avec le quotidien du poste.
Pourtant, selon une étude Indeed, 40 % estiment que les offres consultées ne reflètent pas la réalité du travail. Plus inquiétant encore, seuls 13 % considèrent que les recruteurs présentent les missions de manière honnête.
Cette défiance s’accentue lorsque les informations essentielles sont absentes. Toujours selon Indeed, 66 % des chercheurs d’emploi reprochent aux entreprises de ne pas afficher la rémunération, tandis que 56 % regrettent l’absence de détails sur les avantages.
Résultat : les candidats postulent moins, se désengagent plus vite et déclinent davantage les propositions.
Parallèlement, un autre décalage se creuse : celui entre les attentes de recrutement et les profils disponibles.
La dernière étude du Hiring Lab d’Indeed montre que plus de 60 % des offres publiées début 2024 ne mentionnent plus de niveau de diplôme. La montée du “skills-first hiring” relègue peu à peu les parcours académiques au second plan.
Les entreprises privilégient désormais l’expérience, la capacité d’adaptation et les preuves concrètes de compétences.
Dans ce contexte, les diplômes ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir de sélection automatique. Les candidats le savent, et attendent que les offres traduisent cette réalité avec davantage de clarté.
Transparence salariale : une obligation à intégrer d’ici 2026
À partir de 2026, les entreprises de plus de 100 salariés devront afficher une fourchette de rémunération dans chaque offre d’emploi. Cette mesure, issue de la directive européenne sur la transparence salariale, bouleversera les pratiques de rédaction.
Pour les candidats, c’est un gage d’équité. Pour les recruteurs, c’est une opportunité stratégique : celle d’assumer leur positionnement plutôt que de le dissimuler. Ceux qui joueront la clarté auront l’avantage.
Des CV en totale transformation
Le CV n’est plus un simple document listant diplôme et expérience. Il devient un support visuel, interactif et personnalisé.
Selon une étude Canva, 74 % des recruteurs français accordent désormais autant d’importance à la présentation qu’au contenu. Pourtant, 57 % des candidats continuent d’envoyer des CV uniquement textuels, en décalage avec les attentes des employeurs.
L’essor de l’IA accélère cette mutation. En 2023, un tiers des candidats français a utilisé un outil d’intelligence artificielle pour rédiger ou améliorer son CV. Les résultats sont probants : 96 % de ceux qui y ont recours obtiennent au moins un entretien.
Ces technologies ne se contentent pas de corriger une formulation ; elles génèrent des mises en page adaptées aux standards du recrutement, structurent les compétences et réduisent les blocs de texte superflus pour gagner en lisibilité.
Les formats évoluent également. Les portfolios numériques deviennent un atout différenciant : 49 % des recruteurs les jugent décisifs, alors qu’ils ne sont présents que dans 15 % des candidatures. Graphiques, liens cliquables, mini-études de cas… le CV se transforme en véritable outil de démonstration.
Comment bien répondre aux attentes de la Gen Z en recrutement ?
La Génération Z représente désormais la majorité des candidats sur le marché du travail : selon iCIMS, 66 % des postulants ont moins de 25 ans. Pourtant, les entreprises peinent encore à adapter leurs pratiques à ce public exigeant, mobile… et prompt à se détourner au moindre faux pas.
La première attente est la flexibilité. Selon l’étude iCIMS, 40 % des jeunes actifs placent le télétravail et l’organisation hybride en tête de leurs priorités. Ils refusent de revenir à une présence imposée cinq jours sur site et attendent une confiance réelle sur la gestion de leur temps.
Cette quête de liberté s’accompagne d’un besoin de rapidité dans le processus de recrutement : la Gen Z considère 22 jours comme la durée maximale acceptable pour un processus de recrutement. Au-delà, elle décroche, ou accepte ailleurs.
Vient ensuite la relation, souvent défaillante. L’étude JobTeaser / EDHEC révèle que 86 % des jeunes ont déjà été ghostés par un recruteur.
Un chiffre vertigineux, qui alimente une méfiance durable. Pour éviter cela, les entreprises doivent passer d’un processus automatisé à une communication personnalisée et suivie, même en cas de refus.
Enfin, la Gen Z attend du sens et de la considération. Selon le baromètre ISC Paris, 46 % privilégient l’équilibre vie pro / vie perso, tandis que 87 % estiment que la performance passe par le bien-être.
Gestion des compétences : votre plan d'action RH pour 2026
En 45 minutes, découvrez comment faire de la gestion des compétences un outil de pilotage RH à part entière. Ce webinaire animé par deux experts RH de notre partenaire Eurécia vous donnera des conseils et exemples concrets ainsi que deux outils prêts à l’emploi pour piloter vos compétences au quotidien.
Je m’inscrisLeur engagement ne se gagne pas avec un baby-foot, mais avec un management respectueux, des perspectives claires et une culture authentique.
Les Soft Skills, toujours plus importantes
Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans tous les métiers, les compétences humaines ne disparaissent pas, elles prennent au contraire de la valeur.
Selon le rapport Skyhive by Cornerstone, les soft skills comme la communication, la collaboration ou l’intelligence émotionnelle sont jusqu’à trois fois plus demandées que les compétences techniques en Europe.
Même dans les secteurs les plus technologiques, elles restent essentielles pour coordonner, décider et travailler efficacement dans des environnements changeants.
Les données du dernier rapport d’AssessFirst confirment cette tendance : les recruteurs recherchent avant tout des personnes adaptables (69 %), méthodiques (72 %) et capables de travailler en équipe.
L’ouverture aux autres ou encore la capacité à aider ses collègues font désormais partie des critères décisifs. Le savoir-être n’est plus perçu comme un bonus, mais comme une condition de performance collective.
Pourquoi une telle montée en puissance ? Parce que l’IA automatise les tâches, mais ne remplace ni l’écoute, ni la créativité, ni le discernement.
Elle exige au contraire des professionnels capables de collaborer entre métiers, de gérer l’imprévu et d’accompagner le changement. Dans ce contexte, une équipe compétente mais incapable de coopérer devient rapidement un frein.