Le management fragilisé par le mal-être des salariés
Le mal-être des salariés n’est pas un problème isolé dans les équipes. Il touche directement les managers, souvent en première ligne. Ils absorbent les tensions sans disposer des ressources nécessaires.
Une récente étude menée par Factorial et Beyond Research Group montre une réalité alarmante. 83 % des managers français estiment que leur charge de travail perturbe leurs relations avec leurs collaborateurs. Ce chiffre montre que la pression managériale dépasse largement la simple coordination de tâches.
Le manager devient un médiateur permanent entre objectifs et détresse. Il doit rassurer les équipes découragées tout en maintenant les performances.
Il n’a pas le temps de gérer efficacement sa propre détresse, car il se tient aux côtés des membres de son équipe pour les soutenir. Ce rôle d’amortisseur émotionnel n’est pas reconnu ni accompagné.
Les managers ont besoin de soutien pour gérer leur propre charge de travail, de formations pour identifier les problèmes et d’une procédure d’escalade claire lorsque les problèmes dépassent leurs capacités de résolution.
La surcharge administrative accentue cette fatigue. Près de la moitié de leur temps est consacrée à des tâches répétitives sans valeur stratégique.
Les e-mails, tableaux Excel et validations internes grignotent leur énergie. La majorité des managers gagneraient en efficacité s’ils étaient libérés de ces obligations. Pourtant, peu d’organisations revoient leurs processus internes. Le discours sur la simplification reste souvent théorique.
La gestion humaine devient un parcours d’obstacles plutôt qu’un rôle de pilotage. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle disparaît peu à peu. Les managers français travaillent énormément au-delà de leur temps contractuel. Et ce rythme affecte nécessairement leur équilibre personnel.
Les managers subissent aussi un manque de clarté décisionnelle et se voient souvent obligés de prendre leurs décisions à l’instinct.
Ce contexte entretient une perte de sens grandissante. Les managers restent engagés mais ne comprennent plus les priorités. Ils avancent dans un cadre flou, sans boussole ni appui.
Quand le désengagement des équipes se répercute sur la charge managériale
Le mal-être des salariés alourdit mécaniquement la charge de leurs managers. Un collaborateur démotivé demande plus d’attention et moins d’autonomie.
Chaque hésitation se transforme en dépendance hiérarchique. Le manager doit compenser les retards, trancher les doutes et absorber les frustrations. Il devient le garant du climat social alors qu’il n’en possède plus les moyens.
Ce transfert invisible de charge émotionnelle use progressivement les encadrants.
Le désengagement entraîne aussi une difficulté à maintenir la dynamique collective. Les projets ralentissent, les délais s’étirent et les priorités se brouillent.
Les managers doivent relancer sans cesse pour éviter la rupture. De nombreux projets échouent en France à cause d’un manque d’organisation interne. Ce chiffre révèle le poids réel du désalignement entre équipes et encadrement. Le manager devient responsable du chaos alors qu’il n’en est pas la source.
La multiplication des outils numériques accentue ce désordre. En moyenne, un manager utilise quatre systèmes différents chaque jour.
Aucun n’est réellement interconnecté, ce qui crée des ruptures permanentes. Cette fragmentation génère une fatigue cognitive continue. Le manager passe plus de temps à chercher qu’à décider. Il perd en sérénité et en disponibilité relationnelle.
Le désengagement des équipes finit donc par devenir une double peine. Le salarié souffre de perte de sens. Le manager souffre de surcharge invisible. La majorité reste pourtant convaincue qu’un changement est possible. Les managers seraient plus disponibles avec davantage d’automatisation.
Ce cercle vicieux peut donc être brisé. Mais il suppose de traiter le mal-être à la source. Protéger les équipes implique d’abord de protéger ceux qui les accompagnent.
Bien-être salarié et santé managériale, une interdépendance sous-estimée
Le bien-être des salariés et la santé mentale des managers sont souvent traités comme deux sujets distincts. Dans la réalité, ces deux équilibres ne fonctionnent jamais l’un sans l’autre. Une équipe en souffrance entraîne un encadrant fragilisé, et inversement.
Un salarié stressé transmet son anxiété à son supérieur, même sans le vouloir. Le manager absorbe les tensions, les peurs et les doutes. Il devient à la fois soutien psychologique et garde-fou émotionnel.
La surcharge de travail des managers nuit à leur relation avec leurs équipes. Et le lien entre bien-être collectif et stabilité managériale n’est plus théorique. Il est devenu concret et mesurable.
Le climat social, un baromètre direct du mal-être des managers
Un climat social détérioré ne touche pas uniquement les collaborateurs les plus exposés. Il affecte aussi les managers, souvent en silence. Chaque conflit non résolu, chaque tension latente ou chaque baisse de motivation pèse sur leur épaule.
Le manager se retrouve en première ligne dès que le moral des équipes baisse. Il doit identifier les signaux faibles, désamorcer les frustrations et maintenir la cohésion. Ce rôle de régulateur émotionnel est rarement reconnu dans les fiches de poste.
Plus l’ambiance interne se dégrade, plus la pression managériale augmente. Les salariés désengagés sollicitent plus fréquemment leurs responsables. Ils demandent des validations supplémentaires, des arbitrages rapides et des explications constantes.
Ce phénomène s’observe dans les chiffres. Les managers dépassent régulièrement leur temps de travail pour compenser les dysfonctionnements organisationnels. Une partie de ces heures supplémentaires sert à combler la démotivation de certains collaborateurs.
L’usure apparaît alors progressivement. Le manager ne pilote plus son équipe, il la retient pour éviter l’effondrement. Il passe d’un rôle stratégique à une posture défensive. Cette transformation silencieuse crée une fatigue profonde.
Le manque de reconnaissance amplifie ce sentiment d’injustice. Le manager assume les impacts d’un climat social qu’il n’a pas créé. Pourtant, il reste souvent perçu comme responsable des tensions internes.
Ce décalage provoque une blessure invisible. Le manager tient encore, mais sans énergie durable. Il garde la face devant ses équipes, mais doute en coulisses. Les entreprises sous-estiment cette situation.
Elles analysent le climat social à travers les réactions des salariés, mais rarement à travers le ressenti des encadrants. Pourtant, le moral des managers est l’indicateur le plus fiable de la santé d’une équipe.
Un manager serein signifie un collectif régulé. Un manager épuisé signale une zone de turbulence. Ignorer ce baromètre, c’est prendre le risque d’une rupture soudaine.
Des salariés autonomes, un soulagement pour le management
L’autonomie des équipes n’est pas qu’un levier de performance. Elle est aussi un facteur de protection pour les managers. Un salarié capable de décider seul réduit mécaniquement la charge mentale de son responsable.
Un collaborateur impliqué gère ses priorités, sans transfert constant vers la hiérarchie. Il prend part aux solutions plutôt que d’alimenter les problèmes. Il crée un climat plus stable et plus respirable.
La plupart des managers sont plus disponibles pour leurs équipes lorsqu’une partie des tâches est automatisée. La question n’est pas la motivation des managers, mais la qualité de leur environnement. En renforçant l’autonomie interne, on restaure leur rôle de leader plutôt que de pompier.
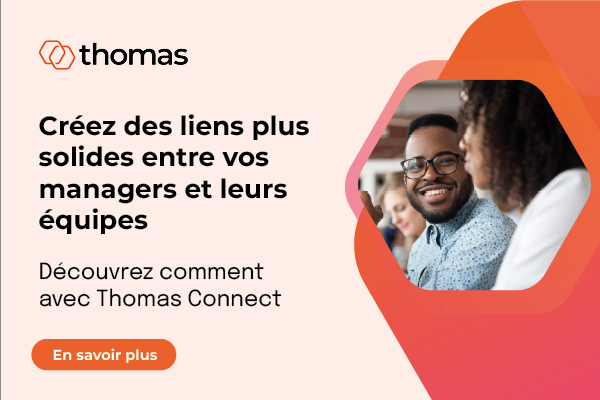
Repenser l’organisation pour protéger à la fois salariés et managers
La prévention du mal-être ne peut plus reposer uniquement sur des actions individuelles. Elle nécessite une transformation organisationnelle réelle. Protéger les équipes implique de protéger aussi ceux qui les encadrent.
Le manager ne peut pas être un tampon permanent entre la stratégie et le terrain. Il doit retrouver un rôle d’animateur, pas de régulateur d’urgence.
Cela suppose de revoir la répartition des responsabilités et des charges. Le fonctionnement interne doit évoluer vers plus de fluidité. Les circuits de validation doivent être simplifiés. Les tâches répétitives doivent être éliminées ou automatisées.
Le bien-être collectif ne viendra pas d’un discours inspirant, mais d’un cadre qui fonctionne. Un cadre lisible, stable et soutenant. Un cadre qui laisse de la respiration à chacun.
Les entreprises qui agiront vite éviteront la rupture. Celles qui attendront enverront leurs équipes dans une fatigue chronique. Le choix est désormais clair : réparer le système ou réparer les individus en continu.
Outiller et former pour libérer du temps de qualité
Les managers et les salariés disposent rarement d’outils réellement adaptés à leurs besoins. Les plateformes se multiplient mais ne dialoguent pas entre elles. Cette fragmentation crée du bruit au lieu de créer du soutien.
Automatiser certaines tâches ne remplace pas l’humain. Cela protège l’humain de la surcharge inutile.
La formation joue aussi un rôle clé. Former à la gestion émotionnelle, à la priorisation ou à la communication permet de sortir du mode réactif. Un manager formé gère mieux, et une équipe formée s’autonomise plus vite.
Selon le rapport Gallup 2025, seuls 44 % des managers ont bénéficié d’une formation formelle pour leur rôle. Or, la formation la plus utile pour favoriser le bien-être des employés et la collaboration au sein de l’équipe reste aujourd’hui encore le coaching.
Grâce à ses produits performants, comme sa plateforme de connexion, Thomas Connect peut fournir ce service. Cet outil offre un soutien individuel grâce à des informations issues de l’intelligence artificielle et basées sur des évaluations psychométriques, veillant ainsi à ce que les managers disposent d’un moyen efficace pour réduire la pression.
Instaurer une culture de confiance et de soutien mutuel
La confiance ne se décrète pas dans les chartes internes. Elle se construit dans les interactions quotidiennes entre managers et salariés. Elle repose sur une parole ouverte et une écoute sans jugement.
Un collaborateur en difficulté doit pouvoir exprimer ses limites sans craindre une sanction. Un manager fragilisé doit pouvoir dire qu’il ne tient plus sans perdre en crédibilité. Cette transparence n’est possible que si l’exemplarité vient d’en haut.
Les directions doivent montrer que la santé mentale n’est pas un sujet secondaire. Elle doit être considérée au même niveau que la performance ou la sécurité. C’est ce message qui libère les échanges authentiques dans les équipes.
Le soutien mutuel passe aussi par des rituels clairs. Des points réguliers où l’on parle d’organisation, pas seulement d’objectifs. Des espaces où chacun peut exprimer un besoin avant qu’il ne devienne un problème.
La reconnaissance doit évoluer vers un modèle collectif. Valoriser uniquement les meilleurs entretient la compétition silencieuse. Féliciter ceux qui soutiennent les autres renforce au contraire l’entraide naturelle.
Le rôle des RH devient alors stratégique. Ils doivent former les managers à détecter les signaux faibles. Ils doivent aussi encourager les salariés à co-construire les solutions, plutôt que d’attendre tout du management.
Quelques idées concrètes à proposer aux managers : Instaurer la confiance et responsabiliser ses équipes en matière de bien-être grâce à des réunions régulières et transparentes sur les valeurs communes, l’engagement des employés et les méthodes de travail.
Évaluer les résultats et responsabiliser ses collaborateurs quant aux progrès accomplis pour créer l’environnement qu’elle souhaite : c’est de loin le meilleur moyen de booster le moral, car cela crée un sentiment d’appartenance, permet au salarié de voir les progrès accomplis et l’aide à résoudre les problèmes ensemble.
Thomas Connect peut aider les entreprises à y parvenir grâce à sa plateforme de connexion : elle permet aux managers et à leurs collègues de mieux travailler ensemble, en renforçant la communication, résolvant les conflits et libérant le potentiel de l’équipe.
Grâce à l’intelligence artificielle et à la science humaine, cette solution favorise la création d’équipes plus connectées, plus efficaces et plus conscientes d’elles-mêmes.
La mesure de connexion offre une nouvelle visibilité sur les sentiments de chacun, à travers six facettes différentes, permettant de comprendre les spécificités et de soutenir les collaborateurs au plus tôt.
A propos de l’auteure

Becky est Content Marketing Manager chez Thomas, avec plus d’une décennie d’expérience dans la rédaction et la stratégie de contenu web. Elle a travaillé dans les secteurs des télécommunications, de la finance et de l’enseignement supérieur, et se passionne pour la création de contenus qui créent du lien.
A propos de Thomas
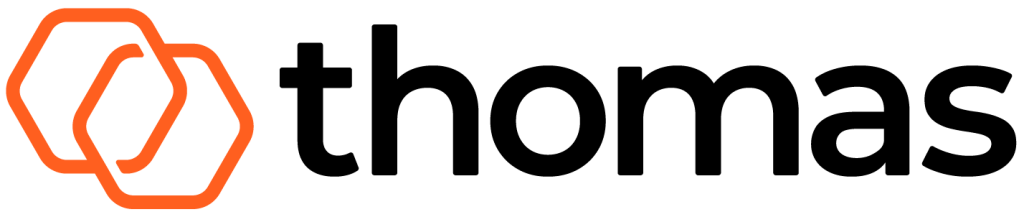
Thomas est votre plateforme tout-en-un dédiée aux personnes, vous offrant, à vous et à vos collaborateurs, une meilleure compréhension de vous-mêmes. Depuis plus de 40 ans, nous développons une science du comportement humain reconnue dans le monde entier, qui aide les individus, les équipes et les entreprises à s’épanouir. Nous avons permis à des millions de personnes à travers le monde de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres.
Contactez-nous pour découvrir comment nos évaluations peuvent aider votre entreprise !

